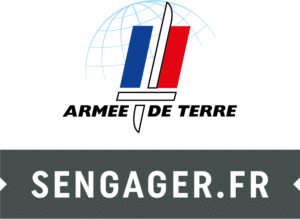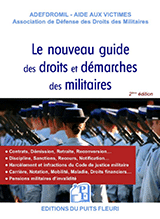M. Paul Stehlin
,
député
Monsieur le président, monsieur le ministre d’Etat, mes chers collègues, qu’il me soit tout d’abord permis de dire quelques mots – nullement dans un sens polémique – sur ce que je sais des conditions dans lesquelles a été élaboré le texte qui est soumis à notre vote.
Comme on l’a rappelé, l’ordonnance du 7 janvier 1959 faisait obligation au Gouvernement de préparer une loi spéciale sur les garanties fondamentales des militaires de carrière et sur les principes de leur statut.
Il se trouve que peu de temps après je prenais les fonctions de major général des armées et que l’année suivante j’étais nommé chef d’état-major général de l’armée de l’air. Je n’ai pas souvenir qu’au cours de cette période de près de cinq ans, quoi que ce soit ait été entrepris dans le sens des prescriptions de l’ordonnance en cause.
Je crois savoir qu’il y a trois ans, le chef d’état-major des armées et les chefs d’état-major de chacune des armées de terre, de l’air et de mer ont été informés – plutôt que consultés – sur la préparation d’un texte relatif au statut général des militaires. Depuis, apparemment, ils n’en avaient plus entendu parler, du moins dans l’exercice de leurs fonctions. Ils n’ont eu connaissance du texte définitif que très récemment, pratiquement en même temps que nous.
Il n’est donc pas juste de dire, dans l’exposé des motifs, que ce travail se fait après consultation des personnels intéressés. Il est vrai que nous lisons aussi, deux lignes plus loin : « L’étude de ce statut aura, en effet, été la première grande tâche du conseil supérieur de la fonction militaire ».
S’il en est ainsi, il serait intéressant, monsieur le ministre d’Etat. que vous nous fassiez connaître l’avis de ce conseil sur le projet du Gouvernement.
Par ailleurs, je crois savoir qu’à aucun moment les chefs d’état-major, par exemple, n’ont été entendus par la commission de la défense nationale sur ce même projet. Or, je pense que, lorsque des discussions de cet ordre ont lieu aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, les intéressés, c’est-à-dire les chefs militaires responsables, sont convoqués et qu’ils donnent leur avis sur des textes aussi importants.
M. le ministre d’Etat chargé de la défense nationale . Monsieur Stehlin, me permettez-vous de vous interrompre ?
M. Paul Stehlin . Volontiers, monsieur le ministre d’Etat.
M. le président . La parole est à M. le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, avec la permission de l’orateur.
M. le ministre d’Etat chargé de la défense nationale . Etant donné les fonctions que vous avez occupées, qui nous ont permis, à cette époque, d’être en rapport, je tiens à répondre à votre observation.
On parlait depuis très longtemps – vous l’avez souligné – de ce projet de statut. Or. en raison de l’immensité de la tâche, en raison aussi – je crois avoir omis de le signaler dans mon intervention à la tribune – de nombreuses difficultés, inéluctable, certes, rencontrées auprès des services du ministère de l’économie et des finances et du secrétariat d’Etat chargé de la fonction publique, d’année en année, cette grande affaire avait été reportée. Je me suis attaché à la mener à bien, car j’avais gardé de l’époque à laquelle vous faites allusion le sentiment que l’effort législatif en faveur de la fonction militaire comportait une lacune.
Le travail a été entrepris, comme il se doit. par le secrétariat général de l’administration des armées, avec la collaboration des bureaux compétents des trois armées. Si la plupart des discussions ont été menées avec les services du secrétariat d’Etat chargé de la fonction publique, puis avec les services du ministère de l’économie et des finances, il n’en demeure pas moins que ce travail, de codification pour une très grande part, a mis en branle l’ensemble des services compétents du ministère.
Puis est arrivé le moment où le texte a été rédigé et où certains choix ont du être opérés.
A ce moment-là – qui ne date pas d’hier puisqu’il remonte au cours de l’année 1971 – le conseil supérieur de la fonction militaire a été consulté.
Dans un premier temps, ainsi que je l’ai dit précédemment, l’idée était venue de faire, pour le conseil supérieur de la fonction militaire, un titre spécial dans ce projet de statut. Mais vous vous rappelez sans doute que nous en avions discuté ici et qu’il en a été décidé autrement, comme vous l’avez d’ailleurs souligné. Nous avons donc créé, par une loi spéciale, le conseil supérieur de la fonction militaire, pour que le statut général de la fonction militaire soit en quelque sorte le premier travail de ce conseil supérieur. Il n’eût pas été logique d’instituer un statut général de la fonction militaire avant de créer le conseil supérieur.
La discussion du projet par le conseil supérieur de la fonction militaire a eu lieu en présence des dirigeants des trois armes.
J’ai ensuite suivi la filière juridique normale, qui a amené le projet, par l’intermédiaire de comités interministériels, au conseil de défense, en présence des chefs d’état-major, puis au Conseil d’Etat, après quoi, bien que je n’en eusse pas l’obligation, j’ai envoyé le document à tous les membres des trois conseils supérieurs – guerre, air, marine – lesquels ont été réunis sous la présidence du secrétaire d’Etat. J’évoquais tout à l’heure cet exemple sans précédent d’une réunion commune des trois conseils, dont nous avons écouté les observations.
Par conséquent, quand on me dit que la concertation a été insuffisante, je me demande ce qu’il fallait de plus !
Aucun texte militaire n’a donné lieu à un tel effort, à une telle discussion où chacun a été entendu.
Vous avez parlé de la possibilité d’une audition des chefs d’état-major par la commission de la défense nationale et des forces armées. Je n’y suis pas favorable, car si l’on peut envisager que le ministre soit accompagné, le cas échéant, d’un chef d’état-major, il doit, en tant que ministre responsable, s’exprimer au premier chef devant vous, et seul, si l’on ne veut pas que quelque chose « cloche » dans le projet.
En d’autres termes, la discipline vaut pour tout le monde. Je ne suis pas de ceux qui estiment qu’elle est pour la base et non pour le sommet.
J’ai, pour moi, la conscience tranquille d’avoir mis au courant de ce vaste problème tous ceux qui devaient l’être. Ils ont été entendus, non seulement en privé, mais aussi devant le conseil de défense et, je le répète, devant les conseils supérieurs. Des notes ont été rédigées, des observations ont été présentées.
A partir de ce moment-là, vis-à-vis de vous, vis-à-vis du président et du rapporteur, vis-à-vis de la commission et vis-à-vis de l’Assemblée, il n’y a qu’une personne : c’est le ministre. S’il devait en être autrement, je crois que quelque chose ne marcherait pas dans l’affaire.
En d’autres termes – pour terminer cette trop longue interruption et en vous remerciant de me l’avoir permise – j’affirme qu’il n’est pas d’exemple d’un texte militaire ayant donné lieu à une aussi longue et aussi complète concertation. D’autre part, s’agissant d’un statut qui n’est pas seulement l’expression de droits et de devoirs de militaires, mais qui est aussi l’expression d’une politique à l’égard de la fonction militaire, il y a vis-à-vis du Parlement un seul interlocuteur : c’est moi. ( Applaudissements sur les bancs de l’union des démocrates pour le République ).
M. Paul Stehlin . Monsieur le ministre d’Etat, je vous remercie des explications que vous venez de fournir. Permettez-moi de vous dire très amicalement qu’elles ne m’ont pas entièrement convaincu. Mais je suis heureux que mes observations aient provoqué ce dialogue entre vous et moi. Cela nous aidera peut-être lorsque nous examinerons les amendements que vous connaissez déjà.
Le grand mérite du projet de loi – je n’ai pas que des critiques à formuler – c’est, en effet, d’avoir réalisé une refonte en un texte unique de toute une série de documents, depuis le décret impérial du 16 juin 1808 sur le mariage des militaires jusqu’à l’ordonnance du 13 mai 1968 portant réorganisation de certains cadres d’officiers et de sous-officiers, en passant par les trop fameuses lois Soult de 1832 et de 1834 sur l’avancement dans l’armée et sur l’état des officiers.
Mais si vous le voulez bien, je bornerai là mes considérations d’ordre général, pour en venir aux objections que soulève malgré tout le projet et à propos desquelles j’ai présenté plusieurs amendements.
Les premières remarques – et peut-être, là encore, serez-vous surpris – portent sur l’exercice des droits civils et politiques.
Nous constatons que le droit d’expression continue d’être strictement réglementé. Il suffisait, me semble-t-il, de rappeler que le militaire est tenu au secret professionnel et à la discrétion, et de préciser qu’il pourrait donner son avis sur les questions de défense qui ne sont pas couvertes par le secret.
Le maintien de la réglementation actuelle – je vous demande, monsieur le ministre d’Etat, de le bien comprendre – laissera la pensée militaire officielle, en France, dans un état de conformisme – je n’exagérerais pas en disant de stérilité – contre lequel s’élèvent tant d’officiers qui, à ma connaissance, n’ont jamais été d’une si haute valeur intellectuelle et morale qu’aujourd’hui.
En revanche, que d’articles et de livres écrits par des civils qui se découvrent une vocation de stratège et de tacticien surtout pour nous entretenir de l’arme nucléaire et de la dissuasion !
Il faudrait alors donner la possibilité aux officiers de répondre dans un sens qui d’ailleurs converge souvent avec les opinions que j’ai exprimées à cette tribune. Je demande donc – ce n’est pas beaucoup – que les militaires puissent exposer librement leurs conceptions en matière de défense, dans les limites, je le répète, imposées par le secret.
Ma seconde remarque concerne le droit de vote et l’éligibilité heureusement rétablis en 1945. Je comprends fort bien qu’un militaire ne puisse pas participer activement aux manifestations publiques d’une formation politique, point sur lequel nous sommes tous bien d’accord. Mais dès lors qu’il est électeur, le droit d’exprimer ses opinions pourrait lui être explicitement reconnu.
Ma troisième remarque a trait au droit d’association. Le projet de loi le soumet – vous l’avez répété – comme dans le passé à un contrôle très strict. Or, je sais que bon nombre de mes jeunes camarades souhaitent bénéficier de la loi du 1″ juillet 1901 pour former des associations composées exclusivement de militaires en vue de la défense de leurs intérêts professionnels. A la rigueur, ce contrôle – vous venez de le répéter -pourrait être délégué au conseil supérieur de la fonction militaire, mais la manière dont celui-ci a, jusqu’à présent, pu exercer ses attributions ne me permet pas d’augurer favorablement de son efficacité pour la défense des intérêts professionnels des militaires. Si, en effet, le Gouvernement continue à refuser le droit d’association aux militaires, du moins devrait-il alors renforcer les attributions du conseil supérieur de la fonction militaire, lui assurer plus d’indépendance qu’il n’en a présentement dans l’exercice de la mission pour laquelle il a été créé.
J’aborde maintenant la question difficile, parce que délicate, des rémunérations. Il faudrait, pour la traiter en toute objectivité et en toute équité – M. le rapporteur y a déjà fait allusion – entreprendre, dans sa vaste ampleur, l’étude approfondie de la fonction militaire moderne.
Nous continuons à appeler capitaine, commandant ou colonel – la même observation vaut, bien entendu, pour les appellations de grades dans la marine – les officiers qui, autrefois, exerçaient à grade égal des fonctions sensiblement du même niveau. Aujourd’hui – et ce que je dis n’a rien de péjoratif bien entendu – tel commandant, par exemple responsable d’une unité aérienne, ou capitaine de corvette commandant un sous-marin, responsable d’une formation dont les matériels relèvent de la technique de pointe, ou chargé d’un bureau d’études techniques, d’un organisme d’essai – il en est de même pour le capitaine de corvette, le médecin-commandant, l’ingénieur équivalant au grade de commandant, etc. – ne peut être assimilé à tel autre commandant dont la compétence professionnelle n’a pas besoin d’être du même niveau intellectuel, culturel, scientifique et technique.
J’entends bien que cette différence est compensée, dans une certaine mesure, par un avancement rapide, des indemnités, des primes. Mais cela ne résout pas le problème. Il faudra bien un jour entreprendre la réforme de la fonction dans le sens de la diversité et de l’échelonnement des valeurs professionnelles.
En attendant, on peut porter remède à cet état de choses en incorporant les diverses indemnités, qui ne sont pas indexées, dans la solde, qui, elle, l’est, bien entendu.
Les militaires en activité sont très sensibles au fait que vous vous efforcez d’obtenir une part importante du budget au bénéfice du titre V, en limitant le titre III au minimum acceptable. Mais les dépenses de matériel sont, en fait, au niveau du constructeur, pour la plus grande part des dépenses salariales. Or, les salaires, dans l’industrie d’armement, ont augmenté de 10 à 15 p. 100 ces trois dernières années, 14 p. 100 en 1971. Les militaires qui n’ont vu relever leur solde que de 5 p. 100 environ ont donc le sentiment que c’est à leur détriment que se fait le progrès matériel et social, du moins dans l’industrie d’armement.
A ce propos, puisque j’avais déposé un amendement au sujet de l’incorporation des indemnités dans la solde, permettez-moi, monsieur le ministre, de vous lire une petite note que je comptais présenter lors de la discussion de cet amendement.
Les salaires des militaires découlent de la grille indiciaire. Le point d’indice est passé entre 1960 et 1971 de 24,05 à 58,72, soit un rapport de 2,483. Dans le même temps, le rapport des taux des salaires horaires, selon l’I.N.S.E.E. a été de 2,455.
Il semble donc que les militaires n’aient pas été lésés. Au contraire ils bénéficieraient d’un très léger avantage, comme tous les membres de la fonction publique. Mais c’est oublier qu’en raison des lourdes sujétions – que vous avez soulignées justement – qui pèsent sur eux, que les militaires vivent en fait de traitements composés à la fois de salaires et d’indemnités.
Ainsi, pour l’ensemble des armées, la masse salariale distribuée était, en 1960, de 1 680 millions de francs pour les soldes et de 1 305 millions de francs pour les indemnités. En 1970 ces sommes devenaient : 3 181 millions pour les soldes et 1 421 millions pour les indemnités. Cela correspond donc à un accroissement de 89 p. 100 pour les soldes mais seulement de 8 p. 100 pour les indemnités. Comme une partie de ces dernières est fonction des soldes, cela veut dire qu’une large part des indemnités, non indexées, a perdu sa signification.
Le fait que la masse salariale n’ait augmenté que de 89 p. 100 alors que la valeur du point d’indice a crû de 148 p. 100 reflète la diminution des effectifs bien connue entre 1960 et 1971, mais cette diminution n’a pas suffit, à elle seule, à gager les accroissements de soldes. Le reste de l’amélioration des soldes résulte de la diminution du volume total des indemnités au profit des soldes.
Pour que la participation des militaires aux fruits de l’expansion soit réelle, il faut que la masse salariale totale, solde plus indemnités, s’accroisse selon le taux des salaires calculés par l’I.N.S.E.E.
Pour qu’il en soit ainsi, c’est un milliard de francs de plus qui aurait dû être inscrit au chapitre des traitements. Même en tenant compte du fait que beaucoup d’indemnités de 1960 étaient liées à l’emploi, en particulier outre-mer, il subsiste une importante dégradation dans le pouvoir d’achat des militaires. La seule solution empêchant les mesures catégorielles de fondre comme neige au soleil, pour leur laisser le caractère de compensation de sujétions militaires, est donc de les lier aux soldes.
C’est là un point important des demandes exprimées par les militaires dans leur ensemble.
Pour ce qui concerne la notation, il conviendrait de fixer un peu plus clairement les critères de notation en considération. Par un amendement, je suggère que les notes soient systématiquement communiquées aux intéressées.
La notion de propriété de grade sur laquelle vous vous êtes étendu, monsieur le ministre, est indirectement reprise dans le projet par l’énumération des cas exceptionnels dans lesquels un militaire peut perdre son grade. Je crains cependant que cette expression ne fasse illusion. Si les droits et les prérogatives de l’état d’officier se rattachent au grade, l’emploi est à la disposition du Gouvernement. Cela est fondamental.
M. le ministre d’Etat chargé de la défense nationale . C’est fondamental ! Nous tenons cela du maréchal Soult et nous sommes tous pour le maréchal Soult !
M. Paul Stehlin . Non, je veux dire qu’il ne faudrait pas, monsieur le ministre, que cette expression : « la propriété du grade » fasse illusion.
Ce qui importe, en vérité, pour les militaires – puisque nous parlons de rémunérations – c’est l’emploi pour lequel il devrait y avoir des garanties supérieures. Tel est bien l’objet de ce débat et des amendements ont été déposés sur ce point.
Je pourrai surtout, en raison de mes fonctions passées, vous parler longuement du délicat et douloureux problème de l’avancement. Je crains que la Ve République n’ait pas réussi tout à fait – je dis bien : réussi tout à fait – à mettre fin autant qu’il eût été souhaitable aux abus dont nous avons été les témoins sous les IIIe et IVe Républiques. ( Protestations sur les bancs du groupe socialiste .).
M. René Ragaudie . Nous en connaissons quelques-uns actuellement.
M. Paul Stehlin . Ce n’est pas une critique que j’adresse aux IIIe et IVe Républiques, mais je parle de certaines constatations que j’ai faites dans l’exercice de mes fonctions.
Il est normal que les choix soient faits par la hiérarchie.
M. Max Lejeune . Je ne suis pas du tout d’accord, monsieur Stehlin.
M. Paul Stehlin . Dès lors qu’existe un statut général des militaires ce statut ne devrait-il pas, à notre époque surtout, prévoir la possibilité d’un recours contre le refus d’inscription au tableau, la communication du dossier à l’intéressé, l’institution – pourquoi pas – d’une commission paritaire comparable à celles de la fonction publique ? ( Mouvements divers ).
Ce disant, monsieur le ministre d’Etat, je me fais l’interprète d’officiers qui sont parfaitement disciplinés mais qui ont eu à souffrir des conditions dans lesquelles se fait quelquefois l’avancement. Ma proposition n’a rien de révolutionnaire, ainsi que le disait tout à l’heure M. le président de la commission de la défense nationale.
Pour conclure, j’évoquerai brièvement le pécule pour carrière courte. A ce sujet, je fais mienne la remarque de M. le rapporteur, quand il écrit :
« On ne saurait sans paradoxe présenter comme une nouveauté ce qui est essentiellement en fait l’instrument d’une meilleure gestion des personnels et rien de plus.
« Cette mesure n’a pas pour but de rendre la carrière militaire plus attirante, mais de faciliter le départ de ceux qui y sont déjà. »
A ce propos, j’ai été une fois de plus victime de l’article 40 de la Constitution. J’avais, en effet, proposé un amendement au sujet de ce pécule ; car je constatais que, loin de constituer un avantage, l’éventualité de la carrière courte est un risque et un inconvénient auxquels le militaire de carrière est exposé et qui n’existent pas pour les fonctions civiles.
Il est équitable que la loi prévoit de substantielles garanties et compensations pour tous les militaires sans aucun contingentement, lequel introduit une notion d’arbitraire inadmissible.
En présentant mon amendement, j’ajoutais – et c’est surtout pour cette raison que je me suis vu opposer l’article 40 – que la somme perçue ne devrait pas être soumise à l’impôt.
M. le ministre chargé de la défense nationale . Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur Stelhin ?
M. Paul Stehlin . Je vous y autorise bien volontiers, monsieur le ministre, d’autant plus que le dialogue est permanent.
M. le président . Je signale qu’il faut aussi l’autorisation du président.
La parole est à M. le ministre d’Etat, avec l’autorisation de l’orateur.
M. le ministre d’Etat chargé de la défense nationale . Comme il faut deux autorisations, je n’ai pas voulu les demander tout au long de votre exposé, monsieur Stehlin. Car j’aurais dû vous interrompre à chaque instant.
Mais, dans ce cas précis, il y a, comme on dit, une erreur matérielle.
Le pécule n’est donné que si on le demande.
En aucune façon, la carrière courte n’est imposée ; c’est une facilité donnée à qui est volontaire. Dès lors, votre raisonnement pèche par la base. J’ajoute que c’est une mesure sociale qui, contrairement à ce que vous paraissez penser, en tout cas, à ce que vous avez dit, est assez novatrice. Actuellement, deux catégories d’officiers peuvent avoir une carrière courte : la première que l’on trouvait fréquemment il y a un siècle, dont je reconnais qu’elle devient rarissime, celle des officiers issus de familles aisées, qui après dix ans, douze ou quinze ans passés sous l’uniforme, quittaient l’armée et géraient leurs biens. Cette catégorie – je le répète – est en voie de disparition, si elle n’est pas déjà totalement disparue.
La seconde catégorie, dont les effectifs sont plus nombreux et combien plus justifiés, est celle des officiers et, à certains égards aussi, des sous-officiers – notamment dans l’armée ou vous avez servi – dont la qualité scientifique et technique est telle qu’au bout d’un certain nombre d’années de métier, ils peuvent trouver très facilement dans la vie civile une carrière intéressante, d’un point de vue tant professionnel que matériel.
Une disposition, dont le statut prévoit qu’elle sera applicable à qui en demandera le bénéfice, a pour objet de permettre à la grande majorité des officiers, qui ne sont ni dans l’une ni dans l’autre de ces deux catégories, de se trouver à égalité avec les autres, je veux parler des officiers qui n’ont pas de situation ni de fortune personnelle, et dont les qualifications et les connaissances techniques ne sont pas de celles dont tel ou tel secteur de l’économie nationale a besoin.
Dès lors, on leur permet, s’ils le demandent, d’une part, de bénéficier d’une mesure appliquée déjà depuis plusieurs années, c’est-à-dire d’un certain recyclage, l’armée continuant pendant quelques mois à payer leur solde, d’autre part, ils sont munis d’un pécule, loin d’être négligeable puisqu’il correspond à environ quarante mois de leur solde.
En d’autres termes, sans vouloir le moins du monde parler de ce propos de réforme importante, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une mesure très intéressante.
Monsieur le député, encore une fois, nous sommes en temps de paix et nous souhaitons que nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants y demeurent. Dès lors, l’armée a besoin, par la force des choses, d’un très grand nombre de jeunes officiers et d’un nombre moindre d’officiers de grades élevés.
Que faire ? Fallait-il, comme on l’a fait entre les deux guerres, réduire brutalement les places offertes aux concours d’entrée dans les écoles militaires, c’est-à-dire priver l’armée de jeunes hommes pour ne pas l’encombrer d’un trop grand nombre d’officiers de grades élevés ? C’est une mauvaise solution et je crois que vous partagez mon opinion sur ce point.
Il est bon, à tous égards, que l’effectif des jeunes officiers soit très élevé. Nos écoles militaires sont d’une qualité exceptionnelle et nous leur avons consacré des efforts considérables ces douze dernières années. Il est donc bon que le nombre des admis aux grandes écoles militaires reste important et qu’il corresponde aux besoins des forces armées en jeunes officiers.
Pour des raisons diverses, certains jeunes officiers ou ne pourront pas ou ne voudront pas accéder aux grades supérieurs. Ceux qui auront les connaissances techniques et scientifiques – et ils sont nombreux – continueront à s’en aller, ce qui leur deviendra de plus en plus facile grâce à la haute qualité technique de l’enseignement qu’ils auront reçu.
Il en est d’autres qui n’ont peut-être pas ces facilités, mais que le pécule, accompagné de possibilités d’études et de « recyclage », permettra d’aborder une seconde carrière.
Croyez bien, monsieur le député, que cette perspective, toute limitée qu’elle soit et qui est réservée à ceux qui le demanderont, j’insiste bien sur ce point, représente pour des jeunes qui se présentent aujourd’hui à l’entrée des écoles une chance de passer, en temps de paix, quelques années de leur vie sous l’uniforme, comme ils le désirent d’exercer un commandement comme ils le souhaitent et, par la suite, d’aborder une seconde carrière dans des conditions qui seront financièrement facilitées.
A partir du moment, je le répète, où il s’agit d’une possibilité qui ne s’offre qu’à la demande, je ne vois pas la critique qu’on peut faire à cette modalité, bien au contraire.
L’expérience des prochaines années nous éclairera, mais il semble qu’il y a là une innovation utile à la société militaire, mais aussi à la vie économique nationale.
M. Paul Stehlin . Je vous remercie de nouveau, monsieur le ministre.
Voyez, monsieur le président, l’avantage que peut présenter ce dialogue : en quelques instants, nous avons eu les explications nécessaires pour mieux comprendre ce texte.
Vous venez, monsieur le ministre, de nous parler des carrières courtes et de nous apporter certaines justifications du pécule. Mais les associations autorisées d’officiers et de sous-officiers en retraite ont pourtant souligné – et elles continuent de le faire, d’après les notes que nous avons reçues – le grand risque que présentent ces carrières courtes. C’est ainsi que ces dernières années, des « dégagements de cadres », quelquefois très importants, ont été opérés, et souvent des officiers et des sous-officiers ont dû partir dans des conditions qu’ils n’avaient pas souhaitées. Le pécule représente donc pour eux une juste compensation.
J’ajoute que le Gouvernement aurait peut-être dû en faveur des sous-officiers, reprendre les articles 20 et 21 de la loi du 30 mars 1928 sur la possibilité de postuler des emplois réservés dans certaines conditions de durée et d’âge.
J’en viens à ma conclusion.
Le projet de loi qui nous est soumis ne répond pas tout à fait aux espérances d’une longue attente. Il semble surtout – malgré les explications fournies par M. le ministre – que l’objet de ce statut n’ait pas été parfaitement compris par les auteurs de ce texte. Car il a bien fallu que quelqu’un le rédige ce statut.
M. le ministre d’Etat chargé de la défense nationale . L’auteur, c’est moi.
M. Paul Stehlin . Vos collaborateurs, monsieur le ministre,
M. le ministre d’Etat chargé de la défense nationale . Vis-à-vis de vous, c’est moi.
M. Paul Stehlin . Disons que vos collaborateurs, sous votre haute autorité, l’ont rédigé.
L’objet de ce statut est essentiellement de maintenir et si possible d’élever le nombre et la qualité des candidatures à la carrière militaire, à tous les niveaux. Or si j’ai pu dire, il y a quelques instants, que nos forces armées comptaient encore un bon nombre d’officiers – cela vaut aussi pour les sous-officiers – de la plus haute valeur, il faut bien constater que nombre d’entre eux quittent prématurément la carrière militaire, de leur plein gré, certes, au profit – et c’est humain – d’emplois plus lucratifs. On peut le regretter, mais nous en sommes souvent témoins.
Je me souviens, par exemple, que lorsque nous avons visité ensemble l’école de l’air de Salon-de-Provence je vous ai indiqué que tel ou tel jeune sous-officier de qualité, technicien de valeur formé à Rochefort, était retenu d’avance par tel ou tel industriel.
Cela prouve sans doute la qualité de l’instruction qui est dispensée dans l’armée, mais c’est celle-ci qui en fait les frais. Mieux vaudrait pour elle conserver ses éléments de grande valeur.
En vérité, monsieur le ministre, malgré ce que vous venez de dire, ce texte semble avoir été rédigé à un niveau administratif où toutes ces fonctions ne sont peut-être pas complètement connues, où – les intéressés eux-mêmes me l’ont déclaré – le dialogue n’a pas été suffisant.
Quant au conseil supérieur de la fonction militaire, il n’a pas vraiment collaboré à la préparation du statut, il n’a pu émettre que des voeux, que nous retrouvons, implicites, dans le rapport envoyé à tous les députés par l’association nationale des officiers en retraite, qui a synthétisé les travaux de plusieurs associations militaires.
Je le répète, ce projet contient d’excellentes choses, et nous pourrons peut-être l’améliorer encore à la faveur des nombreux amendements que l’Assemblée va devoir examiner pendant deux jours et deux nuits. ( Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .).
Je crois, monsieur le président, ne pas avoir dépassé le temps qui m’était accordé.
M. le président . Je vous remercie de votre discipline.