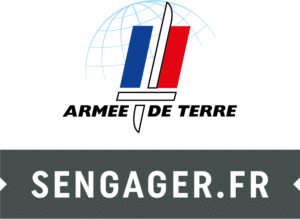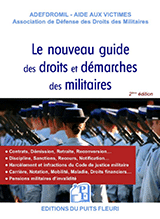Cet article est extrait du n° 165 – janvier-février-mars 2004 de la Tribune des Sous-officiers et reproduit avec l’autorisation de cette revue.
Le rapport laisse la place à trois sentiments :
Il comporte de bonnes choses ; Il nécessitera certainement un certain nombre d’adaptations ; Il comporte des propositions totalement inacceptables sur le fond et la forme.
INTRODUCTION ( pages 1 et 2 )
D’une manière générale, cette introduction met en valeur ce qui doit caractériser nos Forces Armées, compte tenu des évolutions socio-économiques intervenues ces trente dernières années.
On peut souligner deux phrases qui marquent cette perception :
» Les citoyens aspirent… plus que par le passé, à participer aux décisions qui les concernent : il ne suffit plus d’imposer, il faut d’abord convaincre. »
» II paraît donc nécessaire que le statut général demeure celui de tous les militaires, quels que soient les emplois qu’ils occupent, les métiers qu’ils exercent et les conditions dans lesquelles ils les exercent. »
On peut cependant regretter que dans cette introduction la définition de la mission fondamentale de nos armées soit limitée à l’usage de la force ouverte dans le cadre de conflits armés, alors que l’on constate que nos forces sont amenées de plus en plus fréquemment à intervenir dans le cadre d’opérations humanitaires, soit pour assurer la protection de populations civiles, soit pour répondre à des situations dramatiques à la suite de catastrophes naturelles notamment.
Par ailleurs, il aurait été judicieux qu’il soit fait état de la substance du régime juridique du Statut Général des Militaires actuel, à savoir : » la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée » qui constitue la base légale du statut.
Comme il aurait été bien que les analyses qui sont faites et les propositions qui en découlent soient référencées aux articles de la loi actuelle, ce qui en faciliterait largement la lecture.
1.- LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Les droits politiques et la citoyenneté
( pages 7 et 8 du rapport : article 9 du statut )
La démonstration de la Commission est pour le moins alambiquée. Elle démontre qu’il y aurait intérêt à ce que les militaires puissent adhérer à un parti politique, pour conclure qu’il n’est pas souhaitable que les militaires soient autorisés à s’affilier à un parti politique au fait qu’il importe que les armées soient neutres et que cette neutralité soit au-dessus de tout soupçon.
Une telle appréciation est une véritable injure aux membres des forces armées.
Alors, après la suppression du service militaire qui a eu pour effet de créer une véritable cassure entre l’Armée et la Nation, et que certains cherchent à promouvoir le rapprochement entre le citoyen et son armée, la démonstration de la Commission est loin d’être convaincante.
En effet, le meilleur moyen de créer le lien « Armée-Nation » serait d’abord que les militaires soient des citoyens à part entière et qu’ils puissent, de ce fait, participer aux activités de la vie de la communauté nationale au travers de ses différents niveaux de proposition et de décision.
Y aurait-il une tare rédhibitoire qui voudrait que les militaires soient cantonnés dans une situation d’accessoires de la Nation. L’appartenance à un parti politique et l’exercice de mandat électif seraient-ils infâmants pour des militaires ?
C’est certainement tout le contraire, car il ne fait pas de doute que le militaire-citoyen à part entière serait à même d’apporter son expérience aux autres corps de la société, et l’exercice de mandats électifs devrait faciliter l’intégration et la reconversion dans les secteurs publics et privés au moment où ils devront quitter le métier des armes.
Jurys d’assises
La proposition de la Commission d’autoriser les militaires à faire partie d’un jury d’Assises n’est pas liée directement au statut général. Cette proposition a pour objet d’entraîner une modification du Code de Procédure pénale. C’est donc une modification de ce code qu’il faut proposer.
Toutefois, il faut se poser la question de la pertinence de la proposition de la Commission. Si, comme elle le dit précédemment, le militaire est incapable d’exercer des droits politiques et d’assumer des fonctions électives pour cause de non neutralité, comment, brusquement, ce même militaire devient-il le héraut de l’impartialité ?
Comprenne qui voudra, mais il y a là une aberration flagrante. On ne peut vouloir une chose et son contraire.
Dans ces deux domaines, il est évident que les membres de la Commission ont fait preuve d’une véritable politico-phobie.
Droit d’association et liberté de groupements militaires
( page 9 : article 10 du statut )
L’analyse de la Commission sur le droit d’association relève d’une véritable phobie anti-syndicale et d’une méconnaissance totale du fait syndical. Ceci n’a rien de surprenant au regard de la composition des membres de la Commission. Les arguments avancés pour interdire aux militaires le droit d’appartenir à des syndicats professionnels ou à des associations professionnelles, sont les mêmes que ceux qui, en 1968, étaient présentés pour faire échec aux propositions de Pierre Messmer en vue de la création du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire.
Alors que les armées sont devenues professionnelles, la haute hiérarchie militaire a la peur au ventre de voir s’instaurer un « contre-pouvoir » concurrent. Considérer qu’un groupement professionnel constituerait une ingérence dans l’activité des forces, la remise en question de la cohésion des unités, voire de la disponibilité et du loyalisme des militaires et serait de nature à constituer des risques majeurs inacceptables, c’est méconnaître la nature même du professionnalisme dans les armées.
A contrario de la démonstration de la Commission, on pourrait admettre qu’aujourd’hui la hiérarchie militaire a besoin de cacher « son incompétence » et les lacunes de sa gestion des ressources humaines derrière un paravent opaque.
Aujourd’hui, plus qu’hier, comme le dit l’introduction, les citoyens aspirent à participer aux décisions qui les concernent : il ne suffit plus d’imposer, il faut d’abord convaincre. Les militaires ne seraient donc pas des citoyens puisque le seul choix qu’ils auraient ce n’est pas celui de la concertation, mais celui de la contrainte.
Par ailleurs, chaque année, les armées vont rendre à l’activité civile environ 30.000 militaires qui seront dans l’obligation de se reconvertir. L’existence d’associations ou de groupements professionnels ne serait-il pas le meilleur moyen de préparer ces personnels à l’immersion dans le grand bain de l’activité économique et sociale de la Nation.
En outre, il serait certainement temps de s’interroger sur le respect par la France des résolutions du Conseil de l’Europe relatives à la constitution de groupements professionnels dans les armées. Il est étonnant que la Commission n’ait pas cru bon de devoir rappeler ces obligations. Il faut croire que l’amnésie a du bon quand on ne veut pas voir les réalités en face.
2.- LES PROTECTIONS ET GARANTIES
Les fonds de prévoyance
La Commission préconise de réduire le montant des cotisations versées aux fonds de prévoyance, en raison de leurs réserves et, par ailleurs, d’étendre l’action de ces fonds afin de couvrir tout risque de décès et d’allouer des secours aux familles en situation particulièrement difficile.
Si l’extension de la couverture sociale est une bonne chose, il ne paraît pas raisonnable de vouloir diminuer les cotisations sans qu’au préalable ait été mesuré l’impact d’une telle mesure, tant en ce qui concerne la nature des risques nouveaux couverts que la hauteur des prestations qui seraient servies aux nouveaux bénéficiaires.
3.- LA CONCERTATION
La concertation, si elle s’est améliorée au fil des temps, n’en est pas pour autant satisfaisante. Les propositions de la Commission conduisent pratiquement à un statu quo. Comme par le passé, l’information continuera à circuler suivant un schéma strictement hiérarchique qui se traduit nécessairement pas un filtrage volontaire ou involontaire des attentes des militaires.
Cette question est, en fait, étroitement liée au droit d’expression des militaires.
Consultation du CSFM
La Commission laisse au ministre de la Défense de décider de l’inscription à l’ordre du jour du CSFM des projets de loi et considère qu’en la matière il n’y a aucune obligation.
Cette analyse n’est pas fondée, car c’est remettre en cause la compétence du CSFM telle qu’elle est définie dans l’article 1er de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 qui précise que !e » CSFM exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des personnels militaires « .
Le CSFM ne peut donc exprimer son avis que pour autant qu’il a été saisi de l’examen des questions qui relèvent de sa compétence. Si l’inscription d’un texte législatif ou réglementaire à l’ordre du jour du CSFM ne doit pas avoir pour effet d’alourdir les procédures, ce n’est pas pour autant qu’il faille laisser un droit discrétionnaire au ministre de la Défense.
Si toutefois il y avait une urgence telle que le retard à l’examen d’un texte puisse engendrer des préjudices aux personnels militaires, il serait plus judicieux de prévoir la possibilité de convocation extraordinaire du CSFM pour l’examen de textes présentant un caractère d’urgence.
Compléter le dispositif
de concertation
Les réflexions de la Commission sur ce sujet sont, comme dans la plupart des chapitres du rapport, marquées par la phobie obsessionnelle de faire obstacle à une concertation qui pourrait s’articuler autour d’organisations de défense des intérêts professionnels des militaires.
La création d’un haut conseil de la fonction militaire n’est peut-être pas inintéressante. Mais ne va-t-on pas créer une institution supplémentaire qui viendra s’ajouter à la masse des organismes parasites qui, aujourd’hui, ne servent à rien ?
D’autre part, les personnalités qui seraient appelées à faire partie de cette institution auront-elles le temps nécessaire pour se consacrer à une tâche aussi vaste ?
Par ailleurs, la Commission considère qu’il n’est pas souhaitable d’instituer un médiateur que les militaires pourraient saisir des litiges les opposant à leur hiérarchie. Cette position n’a rien d’étonnant. Elle s’inscrit dans une démarche sclérosée qui veut qu’en dehors de la hiérarchie, il n’y a pas de voie de recours possible.
La mise en place d’un médiateur serait pourtant le moyen, non pas d’alourdir les procédures mais, bien au contraire, de les alléger en évitant les cascades de recours qui encombrent les administrations et qui se traduisent par des délais très souvent exorbitants qui ne font que pourrir les relations entre administrations et administrés.
Les procédures mises en place en matière civile et pénale ont déjà porté leurs fruits ; pourquoi n’en serait-il pas de même en matière militaire ?
4.- LES REGLES STATUTAIRES
DE GESTION
Contrat de longue durée
La création d’un « contrat de longue durée » est une idée innovante à condition, comme le précise la Commission, que ces contrats puissent conduire à la date de jouissance immédiate d’une pension de retraite, voire à la limite de la durée des services par contrat, sous réserve que cette limite soit supérieure à celle de la pension de retraite.
Le corollaire de cette proposition devrait être une limitation des contrats en cascade. Le contrat initial liant l’engagé aux armées ne devrait pouvoir être renouvelé qu’une seule fois, sans que la durée totale des deux contrats puisse être supérieure à cinq ans.
Principes fondamentaux
régissant la rémunération des militaires
La Commission se livre à une démonstration concernant le classement indiciaire des militaires en fonction de leur position dans la hiérarchie, telle qu’elle est déterminée par l’article 4 des statuts. Ceci n’est pas exact puisque les sous-officiers, en plus de leur position dans la hiérarchie, se voient affectés d’un classement spécifique au travers de trois échelles de solde.
Elle se réfère également au classement des corps de fonctionnaires au travers des catégories A, B et C de la fonction publique.
Au travers de ces deux constats, la Commission en déduit que ce dernier classement ne s’applique pas aux militaires. Il en résulte que leur position indiciaire, dans la hiérarchie générale des agents de l’Etat, ne saurait prendre en considération d’autres « catégories » que celles définies par l’art. 4 du statut général. Partant de là. elle propose de réaffirmer explicitement ce principe.
En fait, il ne s’agit pas d’une réaffirmation, car on ne peut réaffirmer que ce qui existe déjà et ce n’est pas le cas actuellement, puisque rien de tel n’existe dans le statut actuel.
L’introduction d’une telle disposition dans le Statut Général des Militaires aurait pour conséquence de sortir implicitement les militaires de la grille de la fonction publique et d’interdire, par voie de conséquence, la transposition aux militaires de mesures qui pourraient être adoptées dans la fonction publique.
Ce serait, en fait, la réalisation d’un lobby ancien de la haute hiérarchie militaire de voir enfin la possibilité de traiter les militaires différemment des autres corps de fonctionnaires. Ceci constitue un danger considérable, ce serait la rupture au sein de la fonction publique. Une telle disposition serait totalement inacceptable.
Recrutement par contrat de spécialistes déjà formés et expérimentés.
La Commission propose d’élargir le recrutement de militaires « conventionnés » pour des spécialités particulières et, notamment, d’offrir cette possibilité à des ressortissants étrangers.
Il est étonnant que, sur ce dernier point, la Commission ne fasse pas de distinction entre les ressortissants étrangers nationaux des Etats membres de l’Union Européenne et ceux des autres Etats de la planète.
La résiliation du contrat d’engagement.
Les propositions relatives à la résiliation des contrats paraissent raisonnables Toutefois, il faut se poser la question de savoir si la durée de douze mois de préavis n’est pas excessive. En effet, s’agissant d’un militaire qui, sous contrat, souhaite quitter le service, quel qu’en soit le motif, n’y a-t-il pas intérêt à ce que ce délai soit le plus court possible ?
Le lien au service après formation
La Commission, en cas de formation, introduit la notion de la signature d’un engagement comportant obligation de rester en service pour une durée minimale, et la mise en recouvrement d’une indemnité compensatrice à la charge de l’intéressé.
Cette proposition mériterait d’être approfondie.
Il y aurait lieu de faire le distingo suivant la nature des formations, à savoir :
Les formations « LAMPDA », initiales permettant l’intégration dans les armées des nouveaux engagés. De toute évidence, de telles formations ne devraient pas faire l’objet de mise en recouvrement de l’indemnité ; Les formations initiales, techniques ou spécialisées, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour lesquelles l’obligation de service et la mise en recouvrement d’une indemnité compensatrice pourraient être envisagées ; Les formations continues au cours de la carrière, quelle qu’en soit la nature, qui concourent à l’amélioration des connaissances des individus et participent, par voie de conséquence, au maintien de la qualité opérationnelle des forces armées. Ces formations ne devraient en aucun cas faire l’objet d’engagement de services et de mise en recouvrement d’indemnité compensatrice.
ANNEXE 3
5.- AVANCEMENT
On ne voit pas bien l’intérêt de la troisième proposition qui consisterait à modifier l’art. 43 du statut général afin de permettre les nominations et promotions à titre temporaire ; en effet, l’art. 43 est rédigé dans des termes identiques à la proposition de la Commission.
6.- REMUNERATIONS
La première proposition, qui aurait pour objet de sortir les militaires de la grille de la fonction publique, est inacceptable (voir ci-dessus : principes fondamentaux régissant la rémunération des militaires).
Cette proposition se trouve notamment en contradiction avec d’autres.
C’est ainsi que, notamment dans le chapitre consacré aux limites d’âge, on peut lire :
» Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées [MITHA] sous-officiers conservent leur limite d’âge actuelle de 57 ans car elle a été déterminée en se référant aux corps homologues de la fonction publique hospitalière « .
Lire également :
Statut général des militaires (SGM)