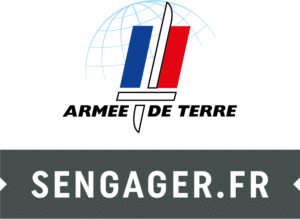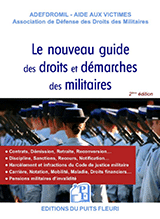L’absentéisme pour raison médicale augmenterait dans les
armées de façon préoccupante et deux chefs
d’état-major s’en étonnent. L’un devant la commission
parlementaire de la défense nationale, l’autre au fil d’une
volumineuse note à destination de ses cadres (1).
Pourtant, ce phénomène n’a rien de surprenant et constitue
l’un des effets collatéraux de la professionnalisation.
Mais vraisemblablement aggravé par la faillite progressive du
soutien santé des unités.
Retour en arrière et tentative d’explication.
Grand-père, raconte-nous une histoire…
Aux temps bénis du service national, deux populations distinctes
se côtoyaient dans nos rangs. L’une, de l’armée d’active,
avait fait une démarche plus ou moins volontaire pour y
accéder (t’as signé, c’est pour en …!). L’autre, celle
des conscrits avait pour objectif principal d’éviter d’en
être, et, malheur échéant, de tout faire pour en
sortir (faire son temps disait-on alors, c’était le perdre).
A l’époque, et sous le prétexte facétieux d’une
absence de sécurité sociale, le militaire du contingent
était fermement invité à confier ses
problèmes de santé aux seuls médecins militaires. Le
professionnel, quant à lui, conservait le libre choix
d’accès au thérapeute en qui il avait confiance. Force est
d’ailleurs de constater qu’il ne rechignait pas à consulter le
toubib de son régiment, souvent aux heures et lieux prévus
à cet effet, mais parfois dans des lieux et circonstances
totalement inadaptés (pendant le cross ou au supermarché du
coin par exemple).
Le Service de Santé des Armées mesurait alors le taux
d’absentéisme médical des militaires d’active chaque
année, et le confrontait à celui des années
antérieures. S’agissant d’une population jeune, dynamique et
volontaire, les chiffres restaient remarquablement faibles, surtout
comparativement à d’autres ministères ou organismes (le
plus élevé concernant, paraît-il, le personnel de la
Sécu).
L’appelé du contingent ne pouvait ni éviter le
médecin en uniforme, ni être soigné ailleurs
qu’à l’infirmerie ou en hôpital militaire (sauf urgence,
mais qui restait temporaire). Ce n’est qu’à l’issue de la phase
aigue de sa maladie qu’il bénéficiait éventuellement
d’une sorte d’arrêt de travail précisément
nommé: Permission à Titre de Convalescence (ou PATC). Et
comme en ces temps lointains, déjà, les autorités
militaires s’inquiétaient de l’inflation des « PATC », leur
délivrance était soumise au bon vouloir du commandement qui
pouvait exiger qu’elles soient prises dans l’enceinte militaire. Ce qui
avait, reconnaissons-le, un caractère assez dissuasif.
On cite ainsi le cas de ces plâtres très encombrants,
pourtant savamment réalisés par des médecins
aspirants complaisants envers leur frère d’armes et dans l’optique
évidente d’un « rapprochement familial », mais qui disparaissaient
rapidement en « PATC » à l’infirmerie.
Que se soit pour la survie de l’espèce, ou simplement pour vivre
plus confortablement, la nature humaine a toujours été
portée à l’adaptation. Celle du conscrit ne
dérogeant pas à la règle, sa maladie invalidante
aiguë se déclarait inexorablement à l’occasion d’une
permission « normale ». Plus précisément la veille ou le
matin même du retour programmé à la caserne. Parfois
sur le quai de la gare, réalisant le célèbre
« syndrome de la gare de l’Est ».
Ainsi, et malgré l’interdit, bien des médecins de famille
rédigeaient les fameux certificats, dans une urgence très
relative. C’était plus une prescription pour prolonger les
vacances, qu’un arrêt de travail pour raison de santé.
Tout aussi prompte à l’adaptation face à
l’adversité, l’autorité flouée faisait alors
contrôler l’impétrant « malade dans ses foyers ». Des
générations de médecins militaires se souviennent
d’avoir arpenté, parfois en vain, des couloirs sombres, des
ruelles lugubres, ou des chemins boueux, à la recherche du soldat
Dupont. Cette mission n’ayant pas grand chose d’héroïque,
elle finissait traditionnellement par échoir au médecin
aspirant de la garnison, malheureusement (ou heureusement suivant
l’approche analytique) appelé du contingent lui-même.
Entre le militaire malgré lui et le contrôleur
malgré lui, il était temps que le jeu de cache-cache se
termine, et c’est assurément mieux ainsi.
L’armée nouvelle…
Exit le conscrit « obligé » et fuyant, il ne reste plus aujourd’hui
que les militaires professionnels. Ceux-là qui, selon les voeux
poignants du CEMAT sont : « unis par une confraternité
d’arme,… commandés par le coeur,… obéissent
d’amitié,… très attachés aux valeurs et traditions
militaires… »
Pourquoi diable, dans ces conditions, s’en trouve-il toujours autant
à préférer la tangente du congé de maladie
à l’affrontement d’une réalité quotidienne aussi
extatique?
Au regard d’une longue expérience, de la multitude des dossiers
traités, et d’un minimum d’intuition, il est possible d’avancer
quelques hypothèses. Les causes semblent à la fois
externes, en provenance d’une ambiance de surpondération de la
demande sur fond de pénurie de l’offre de soins, et internes,
tenant alors à un problème de démotivation
larvée sur faillite du soutien santé des unités.
Les causes extrinsèques : l’ambiance médicale collective
et l’individualisme.
La rédaction d’un « arrêt de travail » est une prescription
médicale, au même titre que celle d’un antibiotique. Ce
faisant, le médecin rédacteur constate soit une
indisponibilité manifeste, totale ou partielle (contention
plâtrée par exemple), soit l’utilité
thérapeutique d’un repos sur une pathologie (maladie aiguë ou
dépression). Et dans ce dernier cas, le repos peut être
rendu nécessaire par l’initiation d’un traitement susceptible de
provoquer des troubles divers. L’arrêt de travail correspond alors
à une période de surveillance, sorte d’hospitalisation en
observation à domicile.
Chacun peut mesurer à quel point l’image du médecin de
famille s’est dégradée au fil du temps. De notable qu’il
était, le généraliste est devenu une sorte de
distributeur d’ordonnances et de certificats divers, souvent serviable,
parfois complaisant. Il se peut que la pléthore de l’offre de
soins des années 80 et 90 ait induit chez le praticien la
nécessité de conquérir et de conserver la
« clientèle », au besoin en répondant à ses attentes,
même les plus illégitimes. Un site aussi caricatural que
juste permet de se faire une idée des grandeurs et servitudes du
métier: http://www.corwin.fr/consultations/menti.htm. A visiter pour le
plaisir.
A décharge de la culpabilité médicale, il faut
reconnaître que la pénurie actuelle en médecins
généralistes n’arrange rien. Qu’il soit civil ou militaire,
le patient victime d’un bon gros rhume mettra du temps à trouver
un cabinet médical sans rendez vous, et passera le même
temps dans une salle d’attente bondée de ses semblables et d’une
foultitude de virus. Quand viendra son tour, la journée sera
largement entamée et il sera légitime de lui prescrire un
arrêt, ne serait-ce que pour justifier son absence du jour.
Mais là, l’administratif s’en mêle. A moins de trois jours
d’arrêt, la sécurité sociale civile ne verse pas
d’indemnités journalières, et le toubib peut être
incité à prescrire les trois jours fatidiques pour
préserver les revenus de son patient. Cependant, s’il prescrit
continuellement trois jours, cette « clause » administrative peut devenir
cruellement évidente…, d’où des variations sur le
thème des sept jours ou de la semaine.
Parmi les patients, se trouvent aussi de véritables « pros » de
l’arrêt de travail. Ils sont capables de bâtir des murs ou de
faire les plus gros travaux pendant de longs mois d’invalidité aux
frais de la sécurité sociale, souvent des suites d’un
accident du travail. Ils semblent intouchables, tout comme les
médecins qui prescrivent (2), et cette
impunité apparente renforce le sentiment général
d’iniquité.
Enfin, il est difficile de ne pas voir dans le recours abusif aux
arrêts de travail l’un des aspect d’une ambiance plus
générale. L’individualisme devient roi, il faut profiter de
la vie, atteindre son épanouissement personnel même au
détriment du collectif, pas vu pas pris, l’argent public n’a pas
plus d’odeur que l’autre, etc.
L’absence de sanction, voire de risque, estompe progressivement
l’impression de nuire à la collectivité, et la connaissance
de prévarications d’ampleur considérable (Elf,
frégates de Taiwan, Exécutive Life, etc.) renforce le
sentiment de bénignité du fait déloyal individuel.
Imaginons un instant les conséquences produites sur des âmes
simples quand un écrivain populaire (3)
refusa publiquement de payer ses impôts au seul motif que son
président de la république d’alors en dépensait une
partie à héberger royalement les siens. Il raconte
même qu’il eut gain de cause. C’est très
démobilisateur.
Les causes intrinsèques : diversité du personnel
militaire, pénurie de l’offre médicale.
La diversité du personnel multiplie à l’infini celle des
aspirations (déçues). En se professionnalisant, et pour
répondre à l’urgence du maintien des effectifs,
l’armée a prétendu pouvoir recruté à tout va.
Les technocrates qui avaient prédit un afflux de
compétences se sont lourdement trompés. Ni l’embellie
économique de la fin des années 90 ni
l’inattractivité résiduelle des contrats précaires
militaires n’ont été convenablement
appréciées.
Grosso modo, et pour faire simple, l’armée de métier
regroupe actuellement trois types de population, aussi difficilement
miscibles qu’auparavant.
La première, la plus nombreuse, est celle des militaires sous
contrat d’engagement ou de carrière. Hormis sa plus grande
sensibilité aux évolutions extérieures, elle a peu
changé. Son objectif est la carrière, mais souvent avec la
certitude de la brièveté de celle-ci. Elle est
proportionnellement peu concernée par le problème, sauf
peut être dans l’immédiate période
précédent une grosse corvée.
La seconde est celle des spécialités recrutées sous
contrat, nettement moins nombreuse mais indispensable au bon
fonctionnement. Ses motivations se limite parfois à la
rentabilisation rapide d’un diplôme tout neuf, en contre partie
d’une première expérience professionnelle à coller
plus tard sur un CV. Le sergent recruteur lui a fait miroiter des
responsabilités, mais sans forcément en avertir le futur
employeur, ni s’appesantir sur certaines contraintes bien militaires.
Cette population est exposée à de grandes
désillusions.
La dernière est constituée d’une foule de jeunes mal
formés, mal diplômés, qui accepte des contrats
volontairement précaires, très dérogatoires au droit
commun. Au delà de la soirée qui vient ou du week-end,
cette jeunesse là s’inscrit très peu dans l’avenir.
Certains, bien évidemment, ont un projet de carrière,
opportunément et judicieusement éveillé par le
sergent recruteur cité supra. Ni la lucidité ni le
réalisme ne guide leurs pas et ils présentent une grande
intolérance à la frustration.
Quelque soit le groupe considéré, et à partir du
moment où le salaire est assuré, le moteur essentiel de
l’ardeur au travail reste l’enthousiasme, ingrédient
nécessaire à transmuter le sentiment pénible de
« travailler » en celui plus enivrant de « servir ».
Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le marqueur le
plus pertinent du niveau d’enthousiasme soit le taux d’absentéisme
médical (en dehors des épidémies virales
saisonnières, bien sûr).
Mais curieusement, et au moment où les hautes autorités se
plaignent de son évolution exponentielle, ce taux n’est plus
mesuré par le SSA. Il n’est même pas certain qu’il ait
réellement augmenté si l’on veut bien considérer que
les appelés indisponibles étaient rapidement
éliminés par la voie de la commission de réforme (4) alors que les professionnels malades pèsent
lourdement et longtemps sur les chiffres par le biais des congés
de maladie, de longue durée, de longue maladie, de réforme
temporaire, etc.
Pour les psychiatres, l’absentéisme médical, du moins son
abus, constitue l’une des principales conduites d’évitement
(ça me fait peur donc je contourne). C’est la réponse la
plus simple et la plus immédiatement disponible.
A chacune des trois populations discernées plus haut, correspond
un exemple récurrent d’évolution défavorable
conduisant à l’utilisation accrue des congés pour raison de
santé.
Ce militaire d’active n’a jamais connu un seul jour d’absence pour
maladie quand des problèmes de sanction, de notation, de
mutation, viennent le déstabiliser dans ses certitudes
professionnelles. En l’absence d’une écoute bienveillante et
compréhensive de son cas par la hiérarchie, tout comme
l’absence d’organisme de médiation efficace, il déprime
et prend le chemin des médecins, des psychiatres, et des
vacances prolongées.
Cet autre a été recruté pour sa formation
universitaire et son diplôme d’informaticien. Persuadé
d’être associé à de grands programmes
d’informatisation militaires, il se retrouve submergé par des
tâches d’entretien du matériel informatique dans une
caserne tristounette. La désillusion est aggravée de
l’incompréhension environnante pour qui l’informaticien est bien
celui qui dépanne l’imprimante. Sans espoir
d’amélioration il demande à démissionner mais se
heurte à un mur. Là encore, le médecin puis le
psychiatre lui donnent le moyen de changer de direction.
Cette gamine a été engagée pour un an renouvelable
dans la capitale. Le sergent recruteur lui a fait miroiter un « logement
gratos et des thunes », mais est resté discret sur les
impératifs de la vie en collectivité et la
disponibilité peu propice aux « plans » du vendredi soir. A force
de tapage, de pleurs et de bagarres, ce sont les autorités qui
finissent par supplier le médecin militaire de mettre un terme
au contrat.
On pourrait multiplier les exemples à l’infini, car il existe
autant de variantes que d’individus, mais bien des cadres
reconnaîtrons ici, peu ou prou, ce qu’ils vivent au quotidien.
De la pénurie de l’offre militaire de soins.
Jusqu’à très récemment, et pour reprendre l’exemple
du gros rhume, le militaire professionnel pouvait se pointer à la
caserne et passer par l’infirmerie voir le toubib. Il avait même le
loisir de téléphoner avant, pour ne pas attendre
derrière les appelés qui s’étaient portés
pâles en prévision de la prochaine manoeuvre.
Intra muros, et en fonction de son état, on lui prescrivait
(donnait souvent) de quoi aller mieux, et parfois lui conseillait de
prendre un ou deux jours de repos en fonction de la gravité des
symptômes.
Il existait même des lits dans l’infirmerie où l’on pouvait
surveiller le quidam et vérifier l’efficacité (ou non) de
la thérapie administrée.
C’était le bon temps.
Puis les médecins militaires ont commencé à
disparaître du paysage, partis en retraite, en OPEX, en
congé de maternité, parental, à l’hôpital.
Quelques rares fois malades eux-mêmes, en CLD ou en examen, en
prison, voire suicidés.
Les états-majors ont mollement réagi et le SSA a
répliqué que la priorité était sur les fronts
de l’Est et d’ailleurs. Aux portes des infirmeries de l’armée de
l’air on placarda l’avis surprenant que ces lieux étaient
réservés aux visites d’aptitude, et que les médecins
civils, la sécurité sociale et les mutuelles militaires se
chargeaient du gros rhume comme du reste.
Curieusement c’est le chef d’état major de cette même
armée de l’air qui appellera plus tard l’attention de la
commission de la défense nationale à l’assemblée sur
l’augmentation de l’absentéisme médical. Sans
forcément conscience des relations de cause à effet.
Au niveau de l’offre hospitalière de soins, les lits des
infirmeries ont été supprimés, tenus pour inutiles,
voire dangereux. Les hôpitaux militaires de proximité ont
fermé pour cause de présence de l’offre civile locale (et
parfois même en l’absence de celle-ci : Papeete, Cherbourg,…).
C’est de l’externalisation forcenée.
Les délais de consultations spécialisées
auprès des HIA résiduels sont devenus rédhibitoires,
prolongeant d’autant les congés de maladie quand l’avis d’un
spécialiste est nécessaire à la reprise du travail.
Dès lors…
Qu’on le veuille ou non, tout concoure à l’augmentation de
l’absentéisme pour raison médicale. Et nous sommes sans
doute encore loin des niveaux « civils ».
Il n’est pas évident qu’un renforcement des contrôles
(certes quasi inexistants à l’heure actuelle), ni une aggravation
des mesures coercitives (dont certaines dérogent
déjà au droit commun (5)),
réduiraient cette amplitude, ou infléchiraient la
progression.
Ces actions n’agiront de surcroît que sur la marge « abusive » des
congés de maladie de type « arrêt de travail ». Pour la masse
énorme de l’absentéisme résultant des autres
congés statutaires, seuls les efforts sur la qualité du
recrutement, sur l’attractivité permanente, sur la
fidélisation et sur le déroulement de carrière
peuvent avoir un effet durablement réducteur.
En définitive, il s’agit d’inciter à servir avec
loyauté en cultivant l’enthousiasme, plutôt que par la
crainte en agitant le bâton.
Mais qui donc a dit: « plus un militaire punit pour se faire obéir
moins il est apte à commander » ?
(1) CEMAT, « vers l’armée professionnelle
2008 »
(2) En fait de nombreux médecins sont
épinglés pour abus de prescription et les contrôles
de la CNAM sont efficaces. Sans compter la dénonciation, photos
à l’appui, par de charmants voisins.
(3) Jean-Edern Hallier.
(4) Cette « utilité » de la
commission de réforme vient d’être réhabilitée
pour éliminer tout militaire professionnel reconnu inapte
définitif. Il existe là un réel danger sur les
droits statutaires à congés pour raison de santé.
(5) Révélation du diagnostic
médical par médecin prescripteur au médecin
militaire agissant comme médecin de l’employeur.