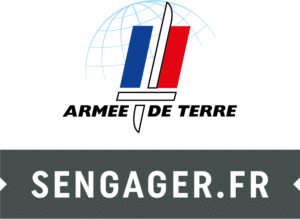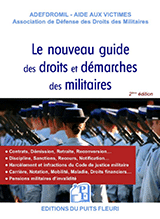Depuis sa création par la loi du 16 février 1791, la gendarmerie nationale se définit comme une force militaire dont la mission principale est d’assurer la paix et la sécurité publiques.
Force armée, la gendarmerie participe à l’exécution de la politique générale de la défense, sur le territoire national comme sur les théâtres d’opérations extérieures.
Dans l’exécution de ses missions de police, elle est une force publique, investie d’un pouvoir de contrainte, mais aussi un service de proximité attentif aux sollicitations de nos concitoyens.
Cette dualité de mission fait de la gendarmerie nationale une « troisième force », en mesure d’intervenir dans un spectre très large de situations, allant de la sécurité publique et de la police judiciaire au maintien de l’ordre dans les contextes les plus dégradés, voire à la participation aux conflits armés.
Le caractère militaire du statut des officiers et sous-officiers de gendarmerie, associé à l’obligation d’occuper un logement concédé par nécessité absolue de service, permet de disposer d’un service à la fois polyvalent et réactif, disponible et adapté aux besoins de la population. En outre, le statut militaire autorise une forte déconcentration des unités qui aboutit à une véritable couverture territoriale puisque la zone de compétence de la gendarmerie s’étend sur 95 % du territoire national, en métropole comme outre-mer. Il permet ainsi à la gendarmerie d’intervenir en tout lieu et participe à l’égalité d’accès des citoyens au service public de la sécurité.
Ces caractères essentiels de la gendarmerie, dont certains sont directement hérités de la Maréchaussée, continuent d’apporter quotidiennement la preuve de leur pertinence au service de la collectivité.
Toutefois, le contexte démographique, social et opérationnel dans lequel les forces de sécurité assurent leurs missions est en pleine mutation et appelle de nouvelles synergies.
Cette situation a amené le Gouvernement, dès 2002, à placer directement sous la responsabilité du ministre de l’intérieur l’emploi de la gendarmerie pour ses missions de sécurité intérieure.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la loi organique sur les lois de finances, en instituant un lien étroit entre les politiques publiques et les moyens qui leur sont affectés, a mis en évidence la nécessité de rechercher une plus grande cohérence dans la définition et l’emploi des moyens consacrés à la mission de sécurité intérieure.
Ainsi, il est désormais indispensable que l’organisation et les moyens budgétaires des deux forces de sécurité relèvent du même ministère.
Au plan budgétaire, la prochaine loi de finances consacrera le transfert du programme « gendarmerie » au ministère de l’intérieur, la mission « sécurité » devenant ainsi une mission ministérielle.
Le rattachement organique et opérationnel de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur a donc pour objectif de placer les deux forces de sécurité intérieure sous l’autorité du même ministre, afin de parvenir à une plus grande synergie et une meilleure complémentarité des actions au profit de la sécurité intérieure.
Dans ce cadre, afin de mieux traduire la réalité des responsabilités et des missions de la gendarmerie, qu’elle exerce de manière permanente sous l’autorité du ministre de l’intérieur, il convient de mettre fin au principe de réquisition systématique de la gendarmerie pour les missions de défense et de sécurité civiles, au premier rang desquelles figure le maintien de l’ordre. Cette évolution, tout en respectant le principe de subordination de l’autorité militaire à l’autorité civile, permettra une harmonisation des règles d’engagement des deux forces.
Cette réforme est historique : le précédent texte législatif traitant de la gendarmerie nationale était la loi du 28 germinal An VI, abrogée lors de l’entrée en vigueur du code de la défense. Au tournant du XXème siècle, le décret du 20 mai 1903 était venu, quant à lui, actualiser l’organisation de la gendarmerie et préciser les modalités de son service.
Cette réforme est essentielle : elle pérennise le modèle de pluralisme policier « à la française » auquel notre Nation est attachée. Elle doit être conduite avec la préoccupation de ne pas rompre les équilibres qui permettent à la gendarmerie de remplir la fonction particulière qui lui est assignée au profit de la collectivité nationale.
Tel est l’objet de la présente loi.
*
* *
Un premier chapitre précise les missions de la gendarmerie nationale et organise son rattachement au ministre de l’intérieur.
L’article 1er précise, en premier lieu, la définition des missions de la gendarmerie nationale, tant en matière de sécurité intérieure, de renseignement et d’information qu’en ce qui concerne ses missions de défense militaire.
En effet, la définition actuelle, donnée par l’article L. 3211-3 du code de la défense, ne rend pas compte de l’une des spécificités essentielles de la gendarmerie nationale, qui réside dans sa capacité à s’engager dans les crises de haute intensité, voire dans les conflits armés.
Cet article organise, en second lieu, la répartition des compétences à l’égard de la gendarmerie notamment entre le ministre de la défense, qui tient ses missions de la loi, et le ministre de l’intérieur.
L’article 2 vise à supprimer le principe de « réquisition de force armée » pour l’emploi de la gendarmerie au maintien de l’ordre (il est conservé pour les autres forces armées). Issu de la loi du 14 septembre 1791 portant institution de la force publique, texte abrogé lors de l’entrée en vigueur du code de la défense, le principe de réquisition n’est plus adapté à l’emploi de la gendarmerie au maintien de l’ordre.
L’article 3 place, de manière formelle, les commandants d’unités de la gendarmerie nationale sous l’autorité des préfets.
Un deuxième chapitre modifie certaines dispositions statutaires applicables aux personnels de la gendarmerie nationale.
Ainsi, l’article 4 augmente les limites d’âge des personnels du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, pour les aligner sur celles des personnels opérationnels. L’allongement des carrières de ces personnels permettra à la gendarmerie de se doter d’une véritable capacité de soutien, indispensable à l’exécution de ses missions dans le cadre nouveau qui lui est assigné.
L’article 5 renforce la capacité de la gendarmerie nationale à assurer la couverture territoriale et tire les conséquences des sujétions et obligations imposées aux officiers et sous-officiers de gendarmerie, qui découlent à la fois de leur statut militaire et de leurs missions de police.
L’article 6, quant à lui, organise le transfert au ministre de l’intérieur de compétences en matière de ressources humaines, expressément attribuées par la loi au ministre de la défense.
Un troisième chapitre intitulé « dispositions finales » vise à régler l’application outre-mer de la loi, procède aux abrogations nécessaires et fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.
L’article 7 assure la coordination entre les dispositions créées par la présente loi et certains articles du code de la défense.
L’article 8 abroge le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie. Ce texte contient de nombreuses dispositions législatives, dont le contenu a été repris par d’autres lois et codifié (code de procédure pénale, code de justice militaire, notamment). Ses dispositions d’ordre réglementaire sont, pour l’essentiel, soit reprises dans des textes récents et donc à considérer comme tacitement abrogées, soit frappées de désuétude.
L’article 9 fixe l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009, pour des raisons tant budgétaires qu’administratives.
Enfin, l’article 10 prévoit l’application de la présente loi sur l’ensemble du territoire de la République.
Lire le dossier:
- Texte n° 499 (2007-2008) de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, déposé au Sénat le 21 août 2008
- Travaux des commissions
- Rapport n° 66 (2008-2009) de M. Jean FAURE, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 29 octobre 2008
- Avis n° 67 (2008-2009) de M. Jean-Patrick COURTOIS, fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 octobre 2008
- Amendements déposés sur ce texte
- Compte rendu intégral des débats en séance publique (16 décembre 2008) ; compte rendu analytique du 17 décembre 2008 – scrutins publics
- Petite loi
- Assemblée nationale (dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale)
- Texte n° 1336 transmis à l’Assemblée nationale le 17 décembre 2008
Source: Site du Sénat