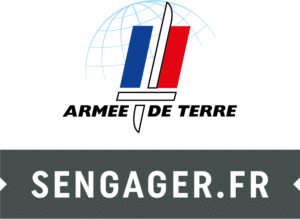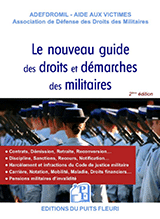Par Albert Mudas
Que penser d’une justice qui nous inflige une amende pour « recours abusif » alors que la prétention du requérant n’est que l’annulation d’une décision de refus d’avancement ?
Vous avez bien lu, le Conseil d’Etat comme toute autre juridiction administrative est en droit de vous infliger une amende s’il estime votre recours «abusif». Mais attention, l’amende ne peut pas excéder 3000€ !!! Tel est le texte de l’article R741-12 du Code de Justice Administrative.
Plusieurs questions vous viennent alors à l’esprit : Qu’entendent les juges par « abusif » ? Sont-ils tenus de justifier cette décision ? Pourquoi tenter un recours si la menace d’une amende pour vouloir défendre ses droits vous pèse sur la tête comme une épée de Damoclès ?
Sur le caractère « abusif » du recours, aucune précision quant aux critères utilisés par les juges n’est apportée par la jurisprudence. Il est seulement fait mention de la possibilité de le « discuter » devant le juge de cassation. Mais comme tout recours en cassation, celui-ci n’est pas sans frais !!!
De plus, les juges n’ont aucune obligation de motivation spéciale. L’arbitraire serait-il le maître mot ? On peut utilement se le demander. Les juges sont uniquement tenus de ne pas commettre d’erreur de droit. Cela restreint dès lors les possibilités d’obtenir gain de cause en cassation.
Est-ce le recours ou plutôt l’amende -et par incidence les pouvoirs du juge administratif- qui serait abusif ?
Dans une récente affaire, un administrateur des affaires maritimes a été condamné à verser 1500€ pour recours abusif alors qu’il demandait son inscription au tableau d’avancement. En effet, cet officier soutient le caractère illégal de sa notation en se fondant sur la divergence entre les appréciations des différents notateurs.
De plus, il se défend en invoquant la Charte des droits fondamentaux. Attention, grosse erreur, tant que le Traité modificatif ne sera pas entré en vigueur, rien ne sert de soulever cette Charte. En effet, dépourvue de toute valeur juridique, il vous sera «vite fait, bien fait» opposer sa « non-invocabilité ». Et c’est bien ce qui, en l’espèce, a été fait.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi tel est le message de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Pierre angulaire du droit constitutionnel d’aujourd’hui, ce texte rassemble nombre de libertés que l’homme doit pouvoir faire valoir à l’encontre de l’Etat. Or, tout le monde n’est pas juriste. Tous ne peuvent pas se défendre au mieux face à des spécialistes du droit qui chercheront la moindre faille pour vous desservir.
Tout le monde veut défendre ses droits même si objectivement ceux-ci ne sont pas fondés en droit. Personne ne peut avoir un regard neutre sur sa situation.
Il paraît donc excusable ou plutôt compréhensible qu’un homme cherche par tous moyens à faire valoir ce qu’il croit, à bon droit, lui être du.
Dans l’affaire précitée, cet officier n’avait peut-être pas des arguments fondés pour une telle demande. Or, il ne peut pas lui être reproché de prétendre à son avancement.
Peu importe les faits. Ce qui mérite ici d’être dénoncé n’est pas ce cas d’espèce mais le possible abus opéré par les juges de leur pouvoir discrétionnaire.
Une question reste donc à se poser : qui abuse de qui ? Le citoyen de son droit au recours ou le juge de son pouvoir de sanction ?
Une dernière remarque peut être faite : certains se diront qu’une telle sanction a un effet dissuasif, bénéfique en ce sens qu’il permet de désengorger les tribunaux d’affaires sans fondement pertinent. Mais à cela, je vous répondrais qu’un processus de désengorgement parallèle au processus de réforme de la carte judiciaire n’est pas des plus démocratiques. En effet, fermer des tribunaux alors que le nombre d’affaires est de plus en plus important et dans un même temps utiliser la sanction comme un dissuasif à effectuer un recours revient à mettre en doute la notion même d’Etat de droit.