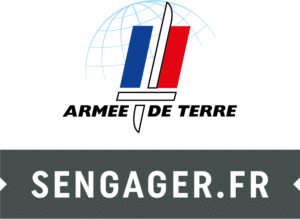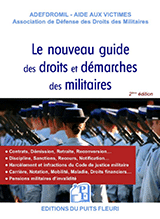GRAND REPORTAGE. Atteints par des tirs de balles, des mines ou des explosifs, les blessés en Afghanistan sont rapatriés à l’hôpital militaire Percy, près de Paris. Ils y sont soignés par des médecins et infirmiers qui connaissent tous la réalité de la guerre.
Plus que de la douleur, insupportable forcément puisqu’il en eut la jambe arrachée, c’est du bruit dont il se souvient d’abord. Le fracas de la mine qui explose sous ses pieds, en pleine nuit, au moment où sa chaussure se pose par inadvertance, par manque de chance, sur un bout de terre piégée. Tireur d’élite au 7e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Bourg-Saint-Maurice, le caporal-chef Michaud, 28 ans, avait pris position sur un monticule, perdu dans les montagnes d’Afghanistan. Les hommes du Génie avaient pourtant ratissé la zone, y détectant quatre mines qu’ils avaient désamorcées. En restait une, mieux enterrée que les autres, qui échappa aux appareils de détection. « Une mine qui explose, ça fait à peu près le même bruit qu’une grenade. Ça vous secoue tout le corps et puis d’un seul coup, ça vous envahit les oreilles, un sifflement strident, un bruit très aigu qui se transforme ensuite en bourdonnement qui reste très longtemps dans les oreilles ». Le soldat a vu sa jambe arrachée, pas coupée net mais en lambeaux, un bout du pied tenait encore péniblement, rattaché aux os par les tendons. « J’ai compris tout de suite que c’était foutu et qu’ils allaient m’amputer. C’était évident. Ma première pensée a été que plus jamais je ne pourrai jouer au foot. C’est idiot, non ? Mais voilà, j’ai d’abord pensé à ça : plus jamais tu ne joueras au foot. »
« Dans trois mois, je pourrai marcher »
Assis dans une salle de l’hôpital des armées Percy, à Clamart, aux portes de Paris, le caporal-chef Michaud parle en croisant et décroisant les jambes. La gauche est intacte, la droite coupée à mi-mollet. Blessé le 14 avril dernier, il n’a été appareillé que lundi. Il ne porte pas encore en permanence la prothèse qui l’accompagnera pour le restant de ses jours. À ses côtés, deux autres jeunes soldats, également gravement blessés ces derniers mois en Afghanistan. Le caporal-chef Brun, 24 ans, lui aussi du 7e BCA. Tombé la veille sur la même colline, presque au même endroit, encore une mine, il a lui aussi subi une amputation à mi-mollet. Le sergent Butant, 28 ans, du 2e Régiment d’infanterie de marine (2e Rima), circulait à bord d’un véhicule militaire. Un engin explosif a fait sauter le blindé. Un des passagers a été tué, les neuf autres ont été blessés. Le sergent Butant a été victime d’une hémorragie interne, de fractures du tibia, du péroné, de la malléole, du thorax. Il porte tout le long de son mollet droit une broche plastifiée fixée par cinq vis, plantées dans la chair. Une énorme cicatrice qui évoque la tête d’un grand taureau orne sa jambe. « Je ne vais pas me plaindre. Dans trois mois, je pourrai marcher, dans neuf courir. Je n’ai subi que quelques opérations. Un de nos copains en est à sa dix-neuvième. »
Près de 24 heures après les attaques qui les ont frappés, tous trois se sont réveillés ici, dans un lit de l’hôpital des armées Percy à Clamart (Hauts-de-Seine). Un grand bâtiment d’un seul tenant, sur cinq niveaux. Un hall clair et lumineux, fait de verre et de bois, avec un plafond cathédrale. À gauche, la chirurgie, à droite la médecine : 1.200 personnels, 369 lits. Une quinzaine d’hommes blessés en Afghanistan y sont actuellement hospitalisés mais des dizaines d’autres, comme les soldats Michaud, Brun et Butant y font des séjours réguliers, alternant périodes de soins hospitaliers et retours à la maison. A priori, Percy est un hôpital comme les autres, avec sa cafétéria où discutent malades et visiteurs, son kiosque à journaux… Pas d’insignes militaires à l’exception d’une salle de rééducation, ornée de fanions de dizaines de régiments. Des couloirs aux murs bleus, aux portes peintes en jaune, sol en lino, liste des médecins à l’entrée des services… Ce qui différencie l’établissement d’un CHU classique, ce sont ses médecins et infirmiers, hommes et femmes, tous militaires. Et ses patients. Ces hommes croisés dans les couloirs, blessés par des tirs d’armes à feu, des mines ou des bombes. Un très jeune homme portant un tee-shirt d’un régiment d’infanterie de marine, assis dans un fauteuil roulant, la jambe droite allongée, affreusement maigre, marquée d’une interminable cicatrice. Un homme à qui manquent trois doigts. Un autre qui plaisante avec un kiné. Il n’a plus de pied droit.
« Un esprit de corps, une fraternité »
Pour rien au monde ils n’auraient voulu être soignés ailleurs. Non qu’ils méprisent ou ne fassent pas confiance à la médecine civile, mais tous décrivent le même besoin, presque vital, d’être hospitalisés au sein d’un établissement militaire où règne, selon eux, « un esprit de corps, une fraternité qui n’existent pas ailleurs ». Le caporal-chef Brun se souvient d’une récente nuit de douleur, passée à gémir sur son lit de Percy. « Mon moignon me faisait tellement mal, c’était à hurler, à chialer. L’infirmière est restée près de moi toute la nuit. Elle ne m’a pas quitté une seconde. Elle m’a bougé, m’a déplacé dans tous les sens pour tenter d’apaiser ma douleur. Le fait qu’elle soit allée sur le terrain, qu’elle sache de quoi on parle, ce qu’on a vécu là-bas, a beaucoup compté pour moi. Elle ne m’a pas laissé tomber. On ne leur rend pas la vie facile mais ils savent ce qu’est la guerre ».
De retour de six mois passés en Afghanistan, le médecin-chef Groud s’est retrouvé dans une France qui, dit-il, ne veut pas connaître la réalité de la guerre menée contre les talibans. « Les gars le disent tous, les gens n’en parlent pas, on ne leur pose presque pas de questions quand ils rentrent. Comme si ça n’intéressait personne. En arrivant ici, au milieu de personnels militaires qui connaissent la réalité du terrain, la violence de la guerre, ils savent qu’ils tomberont sur des médecins et des infirmiers qui, immédiatement, sauront les comprendre ». Tous sont passés par des terrains d’opérations aussi violents que le Rwanda, le Kosovo, la Sierra Leone, l’Irak, l’Afghanistan, la Côte d’Ivoire ou le Tchad… Directeur central du Service de santé des armées (l’équivalent d’un général quatre étoiles dans l’armée de terre), le médecin général Nédellec précise que « la médecine militaire française impose d’être au plus près possible des combattants ». À la différence des Américains (les médecines militaires française et américaine sont réputées les deux meilleures au monde) qui déploient leurs dispositifs médicaux en retrait, plus loin des zones de combat. « Nous sommes au plus près de nos soldats pour une raison, l’obligation de les prendre en charge de la meilleure façon qui soit lors des dix minutes qui suivent la blessure. Ces dix minutes sont absolument cruciales ».
« La vie d’un amputé n’a rien d’un long fleuve tranquille »
Les médecins militaires sauvent trois fois plus de blessés graves aujourd’hui que dans les années 1970. Les soins d’urgence sont prodigués dans les secondes qui suivent, par les soldats eux-mêmes puis les personnels médicaux qui les accompagnent. Particulièrement visés par les talibans, ….
Lire la suite sur le site www.lejdd.fr en cliquant [ICI]
Source: leJDD.fr