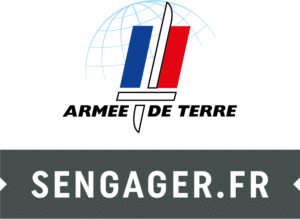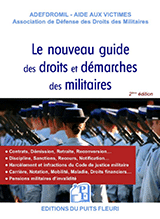A l’instar de l’Empire Ottoman, l’homme malade du XIXème siècle que la victoire de 1918 a fait s’évanouir dans un prodigieux et tout aussi rapide démantèlement sans guère de résistance tant sa disparition était annoncée, la Gendarmerie Nationale, forte de ses quelques 100.000 hommes et femmes, s’enfonce dans la culture du déclin et celle de la disparition prochaine tant son évidente absorption par la Police Nationale semble dans l’ordre des choses. Les esprits s’y sont préparés.
Il n’y a qu’à lire les nombreux forums de discussions Internet, spécialité gendarmique depuis ce fameux mois de décembre 2001, sur lesquels des gendarmes anonymes expriment leur inquiétude et leur fascination quotidienne devant une police qui leur offrirait des conditions de vie nettement plus avantageuses. Les officiers, quant à eux, placés aux différents échelons de commandement, des Communautés de Brigades jusqu’aux Régions, restent galvanisés par leurs missions de police judiciaire pour en perdre leur gendarmitude en ne voyant plus ce qui les distingue de leurs homologues commissaires. Les généraux, de leur côté, anticipant l’absorption, lorgnent sur les grilles indiciaires des contrôleurs généraux de la police nationale et les gradés sur celles des officiers de police. Tout cela va de soi car les résultats de la police quant à la délinquance sont meilleurs et l’outil gendarmique est d’ailleurs régulièrement jugé inefficace, voire même inadapté aux nouvelles délinquances. A renfort d’études et de recherches scientifiques, les gendarmologues d’une voix unanime précipitent cette institution séculaire vers la sortie et accélèrent intellectuellement une absorption souhaitable qui semble mise en oeuvre par les plus hautes instances de l’Etat conformément à la philosophie générale de la RGPP.
Une culture mortifère parcourt l’ensemble des brigades, des unités de recherches judiciaires, des pelotons motocyclistes et des unités d’autoroute au sein desquels les personnels culpabilisent devant l’anachronisme chronique de leur institution. La militarité qui leur reste est jugée complètement obsolète, voire indécente et même considérée de plus en plus systématiquement comme un obstacle à leur modernisation. La culture du résultat, inaugurée en 2002 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, a formaté les esprits en réduisant toute volonté de résistance par l’adoption d’un raisonnement qui a l’apparence de l’évidence et qui s’appuie sur le fait que la gendarmerie n’étant plus efficace sur le plan de la lutte contre de la délinquance, puisqu’elle montre des limites, pour ne pas dire une incompétence totale, quant à la concertation sociale, parce que la recherche du renseignement est abandonnée et, enfin, parce que le service rendu aux citoyens ne correspond plus à la demande : il est donc urgent de procéder à sa fusion puis son absorption par la police nationale.
A force de se croire malade, on risque donc effectivement de le devenir. Se laisser mourir apaise l’angoisse et l’inquiétude de toute une institution mais surtout permet de justifier l’impuissance des décideurs de tous bords et leur volonté de ne plus intervenir auprès du malade (pas d’acharnement thérapeutique).
Non, la gendarmerie n’est pas à l’agonie. Parce que le concept de police de proximité refait surface, il est urgent de changer de médecin pour changer de diagnostic. Plus que des faits et des résultats, il s’agit d’un état d’esprit dans lequel se complaisent les politiques, les décideurs et la recherche et qui ne concourt pas à une bonne appréhension de ce qu’est la réalité de la gendarmerie et de ce qu’elle propose. Pourquoi ne posons-nous pas la problématique gendarmique d’une autre manière, selon une focale résolument gendarmique et non selon le prisme policier : comment faire pour que la gendarmerie, comme outil du maintien de l’ordre public, puisse contraindre l’évolution probable de la délinquance future comme, notamment, les émeutes urbaines, voire même tous ces comportements regroupés sous le terme d’incivilités ? Alors que les délinquants s’adaptent constamment à un appareil policier et qu’ils prennent en compte dans leurs comportements et leurs actions le malaise gendarmique qui participe dans une certaine mesure à l’évolution de la délinquance, il serait sans doute utile de réhabiliter les fondamentaux militaires des personnels, de redonner tout simplement confiance à des gendarmes à qui l’on exige une adaptation trop immédiate, de procéder à une politique systématique de reconnaissance du travail des unités et des personnels, de repositionner le gendarme au sein de la société à l’aide d’une politique de communication efficace et, enfin, de mettre un terme définitif à l’auto-flagellation de toute une institution persuadée de son inéluctable disparition.
Il est encore temps de redresser la barre et il revient sans doute aux gendarmologues de travailler sur la culture de toute une institution qui n’est pas condamnée à disparaître. Il n’est pas question que la Gendarmerie reste cet « homme malade » comme le fut l’Empire Ottoman et qu’on la regarde couler comme le Titanic.