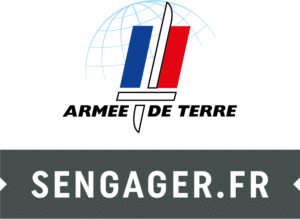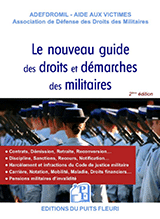La radiation d’un colonel et le départ du directeur général ont semé le trouble dans les rangs des gendarmes, inquiets pour l’avenir de leurs statuts et de leur spécificité. Au gré des mutualisations, c’est bien vers une fusion que l’on semble s’acheminer.
Débarqué avec un préavis d’un mois. Roland Gilles, l’ex-directeur général de la gendarmerie, s’apprête à faire son paquetage, direction la Bosnie, où, dit-on, il devrait occuper le poste d’ambassadeur. Une décision brutale, prise début avril en Conseil des ministres.
Le général, en poste depuis juin 2008, a payé pour le malaise perceptible au sein de la maréchaussée, causé par le rapprochement police-gendarmerie ordonné par le président de la République depuis 2007. Un rapprochement que Roland Gilles a mis sur les rails, bien malgré lui, avec son homologue de la police nationale, Frédéric Péchenard.
Aujourd’hui, c’est un nouveau duo, constitué du même Frédéric Péchenard et de Jacques Mignaux, le nouveau directeur de la gendarmerie, lui aussi général étoilé, qui prend le relais. Symbole du changement : les deux DG ont leur bureau à quelques mètres l’un de l’autre place Beauvau. Un clin d’œil à l’histoire, lorsque l’on sait que c’est un militaire, le maréchal de Beauvau, qui a laissé son nom au XVIII e siècle à l’actuel ministère de l’Intérieur.
Très concrètement, le rapprochement « physique » des bureaux des deux hommes est intervenu quelques semaines après la publication de la loi du 3 août relative à la gendarmerie nationale. Objectif du texte : organiser le transfert organique de la gendarmerie nationale du ministère de la Défense à l’Intérieur.
En clair, le ministère de l’Intérieur est désormais responsable de l’organisation de la gendarmerie nationale, de sa gestion, de son emploi et de l’infrastructure militaire. Il a également la main sur la gestion des ressources humaines de la gendarmerie. Pas moins. Un mouvement amorcé il y a près de dix ans.
En mai 2002, la gendarmerie nationale avait été placée « pour emploi » auprès du ministre de l’Intérieur pour l’exercice des missions de sécurité intérieure. Ne manquait plus qu’à lui donner le pouvoir budgétaire. C’est chose faite depuis 2009. La mission sécurité, scindée en deux programmes, police et gendarmerie, ne relève plus que du seul ministère de l’Intérieur. Le premier exercice voté ainsi l’a été à travers la loi de finances de 2010.
Fusion inéluctable
Une suite logique. Depuis dix ans, la politique de sécurité n’a cessé de gagner en unité. Depuis lors datent les groupements d’intervention régionaux – les fameux « GIR » -, qui regroupent policiers, gendarmes, mais aussi douanes et services fiscaux. En matière de maintien de l’ordre, un commandement unique de coordination des forces mobiles gère depuis 2002 la répartition des forces de gendarmerie et de police. Au final, le rattachement instauré par la loi d’août 2009 « constitue moins une rupture que l’aboutissement d’une évolution commencée en 2002 », remarque le sénateur UMP de l’Isère, Jean Faure.
Et qui semble inéluctablement conduire vers une fusion. Ce qui n’est guère au goût des gendarmes. Astreints à un devoir de réserve strict, ces derniers s’expriment anonymement sur des forums Internet ou dans quelques revues associatives comme L’Essor, qui publie ces derniers temps moult billets d’humeur et témoignages sur le malaise des pandores.
Côté policier, on avoue même être démarché par les gendarmes venant à la pêche aux infos, contournant ainsi le black-out observé par la hiérarchie. Les syndicats de policiers ouvrent même sur leurs sites Web des forums spécifiques pour les gendarmes.
Dans l’ensemble, les policiers sont néanmoins plutôt favorables, si ce n’est indifférents, à la création d’un grand ministère de la Sécurité, comme le révèle la position du syndicat Synergie sur le sujet. Du coup, entre les membres des deux forces de sécurité, les relations peuvent se crisper à tout moment. Les policiers n’ont guère apprécié les propos du colonel Espié, qui, dans une note du 4 février, a critiqué la cogestion syndicats-hiérarchie policière en la matière.
Pour calmer le jeu entre policiers et gendarmes, le ministère a organisé une réunion le 12 février avec les deux directeurs généraux et les syndicats de policiers. Le directeur de cabinet de Brice Hortefeux, Michel Bart, a mis les choses à plat. Documents à l’appui, il a dressé l’inventaire des mutualisations. Très techniques, celles-ci sont d’importance variable, mais ont toutes pour objectif prioritaire de dégager des économies.
En 2009, plusieurs marchés publics visant l’acquisition de matériels communs ont été signés. Dans le lot : cartouches, boucliers pour le maintien de l’ordre, jambières de protection, pistolets automatiques – qui devraient engendrer à eux seuls une économie de 130 millions d’euros ! – ou encore gilets pare-balles. Les marchés d’approvisionnement communs en véhicules de patrouille devraient, eux, déboucher sur une économie de plus de 1,5 million d’euros.
Si l’on ajoute à cette longue liste les mutualisations réalisées ou en voie de l’être en matière immobilière, de logistique et de systèmes d’information et de communication, il apparaît que le rapprochement police-gendarmerie est déjà bien entamé. Et ce même si pour le gendarme et le policier sur le terrain, ces mutualisations n’ont guère de conséquences très visibles.
Ce qui bouleverse davantage les habitudes des gendarmes et des policiers, ce sont les complémentarités dites « fonctionnelles » des missions. Avec la loi d’août 2009 en effet, un boulevard s’ouvre au ministre pour renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie en matière de sécurité.
Les deux directeurs généraux, Frédéric Péchenard et Roland Gilles, ont travaillé d’arrache-pied sur le sujet ces derniers mois pour tenter de répartir au mieux les missions sur chacune des deux forces après un inventaire précis de celles-ci.
Sont visées les missions de police judiciaire, les missions de sécurité routière, les missions d’information générale et de renseignement et d’intelligence économique. Pour mettre fin aux doublons et autres superpositions des services, gendarmes et policiers vont devoir, plus qu’hier, travailler ensemble. Tout l’enjeu étant de savoir qui, des gendarmes ou des policiers, aura plus de poids dans les prises de décision et dans le commandement des troupes.
Revendications à venir
Pour l’instant, la balance penche en faveur des ….
Lire la suite sur le site acteurspublics.com en cliquant [ICI]