Faisant allusion à nos soldats tués en Afghanistan dans la vallée d’Uzbin en 2008, le chef des armées, dans l’allocution prononcée lundi 30 novembre 2009 lors d’une prise d’armes dans la cour de l’hôtel des Invalides, a déclaré que : «Leur mort n’est pas un banal accident. Les faits d’armes ne sont pas des faits divers ». Certains exégètes de sa pensée y voient une désapprobation des procédures engagées par les familles des militaires victimes de cette embuscade. Pourtant tout avocat sait parfaitement qu’on ne peut décréter d’exclure de la compétence des juges certains domaines de l’activité humaine -quand bien même il s’agirait de la force exercée par un Etat à l’extérieur de ses frontières dans le cadre de la poursuite de sa politique par…d’autres moyens.
Certes, une plainte susceptible de mettre en cause la responsabilité pénale de cadres militaires dans la mort de militaires français en opérations extérieures est inhabituelle. Mais il n’y a aucune raison objective pour que les choix, les décisions des chefs à l’origine éventuelle de la mort de militaires subordonnés échappent à une recherche de responsabilité. Il peut s’agir de la responsabilité de l’Etat, si une faute a été commise par celui qui détenait le pouvoir de décision. Il peut s’agir aussi de sa responsabilité individuelle si la ou les fautes commises sont susceptibles de recevoir une qualification prévue par le code pénal. Cette possibilité d’engager la responsabilité de l’individu ou celle de la personne morale publique fait partie des principes d’un Etat de droit, comme la France.
Des arguments fallacieux pour culpabiliser les plaignants.
L’expression du néo-conservatisme, qui règne en France depuis plusieurs années avec le décalage habituel dans le temps par rapport aux Etats Unis, conduit certains à développer des arguments déconnectés de la réalité des opérations. Ces appels à un silence patriotique visent à culpabiliser les familles.
Ces penseurs qui prônent la sacralisation du sacrifice du soldat ou critiquent la possibilité de rechercher la responsabilité éventuelle de ceux qui ont donné des ordres, ont-ils fait un jour l’expérience du combat, de l’attente dans la nuit et le froid et parfois de la peur ? Ont-ils des proches, des enfants qui sont partis sous l’uniforme défendre nos valeurs en risquant leur vie ou leur simple intégrité physique ? Ont-ils expérimenté la douleur de perdre un être cher en se demandant si son sacrifice en valait la peine, s’il n’avait pas été la victime innocente d’ordres mal préparés ou mal donnés, d’un matériel défaillant que la hiérarchie n’avait pu ou pas voulu refuser d’utiliser ?
Un simple exemple récent de sacrifices de militaires suffit à comprendre combien cette culpabilisation des familles est indécente. Ainsi, il a fallu plus de quatre décennies pour que l’Etat reconnaisse sa responsabilité dans l’irradiation et la contamination de ceux qui ont participé aux essais nucléaires et dont beaucoup sont décédés. Fallait-il se taire au nom de la dissuasion nucléaire ?
La prétendue désacralisation du sacrifice du soldat.
Ainsi, ces mauvais Français ne feraient qu’exprimer leur ingratitude et menaceraient l’ordre républicain en désacralisant le sacrifice des soldats morts pour la France. « Ces plaintes touchent au symbolique… Avec cette désacralisation de la mort du soldat, où va-t-on ? Déjà, les chefs étaient terrorisés à l’idée de donner l’ordre d’ouvrir le feu… » (Eric Deroo sur le blog Secret Défense Libération – 29/10/09). Bref, il faudrait que les proches de ceux qui sont tombés pour leur pays gardent le silence, ne posent aucune question, acceptent le sacrifice de la perte d’un fils ou d’un père sans dire mot. Mais, qui souhaite remettre en cause la sacralisation de la mort de ceux qui sont tombés pour la patrie ? Certainement pas ces familles endeuillées pour lesquelles cette sacralisation est justement un réconfort. En même temps, leur refuser le droit de poser des questions à travers une procédure judiciaire ou d’enquête parlementaire comme au Royaume Uni, c’est nier leur existence en tant que citoyens responsables, c’est les transformer en simples pourvoyeurs de chair à canon.
La pseudo « judiciarisation » des opérations militaires présentée comme symbole d’une crise sociétale.
C’est une philosophe, spécialiste de Kant qui voit dans ces actions judiciaires « le symptôme d’une crise culturelle et sociale ». (Monique Castillo sur le blog Défense ouverte – Le Point – 01/11/09)
« Quand on atteint le niveau de l’État, dont l’armée est l’expression – tout comme l’impôt, pourrais-je ajouter ! -, on change de registre. On entre dans un autre domaine, celui du pouvoir public, on ne se trouve plus dans l’univers de l’échange et du contrat. La volonté de judiciariser l’action militaire est un symptôme de crise culturelle et sociale qui s’observe aussi aux États-Unis. En gros : la mort au combat de plus en plus mal acceptée par l’opinion publique. Le phénomène n’est pas étranger à la perception néolibérale que les autorités aussi bien que les particuliers ont de la société : si l’individu seul existe et s’il n’existe que des relations entre individus, on comprend que s’installe une incompréhension grandissante entre l’opinion publique et l’action de l’armée. »
Tout d’abord, on appréciera l’utilisation d’un mot mal aisé à prononcer : « judiciarisation », qui exprime le fait de porter une affaire en justice. L’emploi de ce terme tend à faire croire que le dépôt d’une plainte ou l’introduction d’une demande en justice revêtirait en soi un aspect pernicieux et relèverait en quelque sorte de l’abus de droit.
Il est étrange de considérer que la recherche de la vérité et de la responsabilité éventuelle de certains chefs par un juge, dans la France de 2009, ne constitue pas une action à mener de manière inconditionnelle, c’est-à-dire qu’elle n’est pas un impératif catégorique au sens kantien du terme.
Il est encore plus curieux d’interpréter ces actions en justice comme l’expression d’une crise sociétale. Le juge n’est-il pas dans tout Etat de droit, dans toute société démocratique, le régulateur normal, habituel des différends nés au sein de la société, y compris de ceux nés entre les citoyens et l’Etat ?
Alors que les opérations de police, dans lesquelles des fonctionnaires de l’Etat usent de la force pour remplir leur mission sur le territoire national, sont soumises au contrôle du juge, on ne voit pas pour quelles raisons, l’usage de la force -hors des frontières- par d’autres agents de l’Etat, les militaires, échapperaient à la compétence du juge. Ni l’extraterritorialité des lieux de l’action, ni les problèmes inévitablement soulevés pour conduire des investigations ne constituent des arguments valables pour exclure les dommages causés à ses propres troupes de la compétence du juge administratif ou judiciaire.
Rappelons également que l’engagement du contingent français en Afghanistan ne peut être assimilé à une guerre globale dans laquelle les militaires français défendraient le territoire national ou européen. La force multinationale ne se bat pas contre les Afghans ou contre l’Afghanistan. Sans doute la dangerosité de ces opérations et leur intensité sont-elles supérieures à celles d’autres opérations extérieures comme en ex Yougoslavie ou en Afrique, dont le but de maintien de la paix était plus marqué. Mais cette différence de degré ne transforme pas ces opérations en une guerre qui nécessiterait l’engagement de la nation tout entière et justifierait un esprit de sacrifice particulier.
Nos amis Britanniques, dont nul ne contestera l’esprit patriotique et les valeurs militaires connaissent d’ailleurs des réactions de famille de militaires tués en Irak tout à fait comparables à celle des familles des tués d’Uzbin. Certaines ont déposé voici quelques semaines devant une commission d’enquête parlementaire et d’autres ont engagé des actions en justice sur la base de la convention européenne des droits de l’homme, intégrée voici quelques années dans le corpus législatif britannique sous le nom de « Human Rights Act ».
Bref, il n’y a pas de « crise sociétale ». Il y a tout juste une demande présentée au juge, certes inhabituelle, mais compréhensible.
La Justice a compétence depuis fort longtemps pour connaître des actions militaires et de leurs conséquences.
Il y a belle lurette que la justice s’intéresse aux opérations militaires.
Philippe VI a ainsi soustrait aux juridictions ordinaires » les sergents et soldats employés à la garde des châteaux « par le mandement de Montdidier du 1er mai 1347. La France a ensuite connu une multitude de juridictions militaires jusqu’en 1857, date à laquelle fut élaboré le premier code de justice militaire.
L’objectif principal de cette législation est d’abord le maintien de la discipline, condition fondamentale de l’existence d’une armée. Pendant fort longtemps, le pouvoir disciplinaire intégrait d’ailleurs le droit d’appliquer la peine de mort aux mutins sans autre forme de procès. A titre d’exemple, le capitaine Coignet raconte dans ses fameux « Cahiers », la décimation sur son ordre de la troupe espagnole rebelle qu’il commandait pendant la campagne de Russie de 1812 et qui s’était livrée à des exactions dans un village voisin. C’est ensuite progressivement que l’idée d’une justice militaire spécialisée a vu le jour après les guerres napoléoniennes.
Actuellement, le tribunal aux armées de Paris est compétent pour connaître des infractions commises par des militaires français hors du territoire de la République que les victimes soient d’autres militaires ou des ressortissants du territoire sur lequel se déroule l’opération. (Manuel de droit des conflits armés)
Le principe de la responsabilité de la puissance publique n’exclut pas qu’un agent soit poursuivi devant une juridiction répressive pour des faits qualifiés pénalement et commis dans l’exercice des fonctions.
La responsabilité de l’administration en cas de dommages résultant de son action a été admise à partir de 1873. Elle n’exclut pas pour autant la responsabilité pénale de ceux qui agissent en son nom. Ainsi, un agent public qui a manqué à ses obligations de diligence et de prudence peut être poursuivi. Telle semble être la base de l’action des familles des militaires tués à Uzbin.
A cet égard, le code de la Défense dispose, dans son article L4123-10, que :
… « L’Etat est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux… »
Il est évident qu’il sera difficile pour une juridiction d’apprécier si tel ou tel officier titulaire de telle fonction a mis délibérément en danger la vie de ses hommes ou n’a pas accompli des diligences normales, eu égard à ses pouvoirs, aux moyens dont il disposait et aux difficultés propres à la mission reçue.
Mais, que les généraux se rassurent : si leur responsabilité venait, par extraordinaire, à être reconnue, l’Etat les couvrirait des condamnations civiles prononcées contre eux. Ils n’en seraient pas de leur poche !
Les militaires font certes un métier particulier : celui de l’emploi de la force de l’Etat, en dehors de ses frontières, tout comme les policiers et gendarmes déploient cette même force pour faire respecter la loi sur le territoire national. S’agit-il encore d’une spécificité ? On peut en douter, car ce métier se révèle actuellement moins dangereux que celui des pompiers civils ou des ouvriers du bâtiment ainsi que l’a relevé un rapport du Haut Comité d’Evaluation de la Condition Militaire (HCECM). (secretdefense.blogs.liberation.fr)
De la même manière qu’un chef d’entreprise peut être poursuivi en cas d’accident du travail, les chefs militaires doivent assumer leur responsabilité – celle d’entraîner et de commander des hommes au combat- y compris devant les tribunaux, le cas échéant.
Le droit à la vie des citoyens d’un Etat membre du Conseil de l’Europe doit être protégé.
Cette obligation résulte de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Ainsi, un arrêt Ataman c. Turquie du 27 avril 2006 précise que l’Etat doit « prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ».
Il ne s’agit donc pas d’une obligation de résultat, mais bien d’une obligation de moyens variable selon les circonstances, mais dont les militaires ne sont en aucun cas exclus, y compris lorsqu’ils sont en opérations comme en Afghanistan ou en Irak.
D’ailleurs, au Royaume Uni, une Cour d’appel a reconnu, dans un arrêt du 18 mai 2009 que le droit à la vie prévu dans la loi britannique relative aux droits de l’homme (Human Rights Act) s’applique en opérations et que la responsabilité du ministère de la défense (MOD) est susceptible d’être engagée dans la mort par coup de chaleur d’un soldat en Irak en 2007.
Au-delà des difficultés inévitables que va poser la demande des familles des militaires morts pour la France à Uzbin, on ne peut que soutenir une action en justice qui appelle à une plus grande transparence des opérations extérieures et à une meilleure responsabilisation des officiers, dont c’est l’honneur de commander.
Jacques BESSY, Vice Président de l’Adefdromil
LIRE EGALEMENT:
Soldats tués en Afghanistan : transparence et responsabilisation (site Rue89)
Deux familles de soldats morts au combat en Afghanistan portent plainte (Site La-Croix.com)
Embuscade d’Uzbin en Afghanistan: la plainte de deux familles déposée au Tribunal aux armées (Site France 24)
Embuscade d’Uzbin : des familles portent plainte (Site Le Républicain Lorrain)
Plaintes d’Uzbin : « Une désacralisation de la mort du soldat » (Site secret défense Libération)
Soldats morts en Afghanistan: sept familles portent plainte (Site 20minutes.fr)

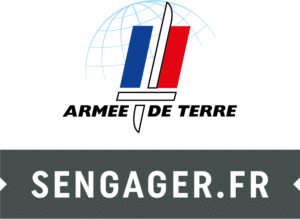

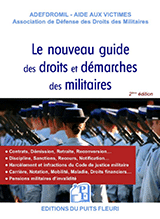

Cette publication a un commentaire
Quant aux opérations extérieures auxquelles ont participé les armées françaises depuis 1962, dans le cadre de nos accords bilatéraux en Afrique, puis plus récemment sous mandats de l’ONU :
– le Parlement n’a jamais voté, ni l’état de guerre, ni l’état de siège ;
– n’ont pas davantage été mises en vigueur les dispositions de l’article 16 de notre Constitution, relatives notamment à l’état d’urgence et aux pouvoirs extraordinaires confiés à cet effet au président de la République.
Nonobstant plusieurs déclarations fracassantes à la presse s’agissant de l’Afghanistan, les faits sont têtus : depuis la fin des « évènements » d’Algérie, quelque quarante années après politiquement, puis juridiquement requalifiés en « guerre », les actions des armées françaises, à l’extérieur comme à l’intérieur du territoire national, sont des « opérations de police ».
Les opérations de police au cours desquelles les agents de l’Etat usent de la force pour remplir leur mission sur le territoire national sont soumises au contrôle du juge.
Y compris d’ailleurs s’agissant des militaires, dans le cadre de la défense aérienne, de l’action de l’Etat en mer, ainsi que des plans de défense Vigipirate et de ses dérivés.
Avec les familles ayant intenté une action au pénal et avec l’Adefdromil, il n’est pas concevable que l’usage de la force hors des frontières par les armées françaises échappe à la compétence du juge.
Les commentaires sont fermés.