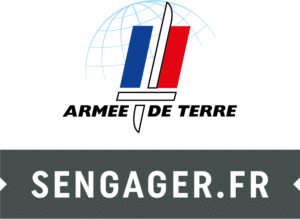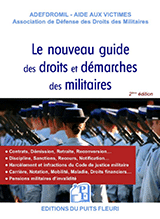Comme le Beaujolais, le directeur général nouveau de la gendarmerie arrive!
Au-delà de la nomination du nouveau préfet de police de Paris, ancien directeur général de la gendarmerie, qui marque la volonté du chef de l’Etat de ne pas s’en laisser compter par l’un de ses ministres, fut-il brillant et populaire; comment interpréter la nomination du nouveau directeur général, officier général, issu des rangs de la gendarmerie, alors qu’une telle nomination ne s’était jamais produite depuis 1947 ?
S’agit il d’un geste fort du pouvoir politique voulant montrer le lien unissant la gendarmerie aux forces armées pour lutter contre la pente naturelle qui conduit les gendarmes dans les bras des policiers ou bien n’est ce pas plutôt une nomination de circonstance visant à assurer la continuité de la gestion d’une institution fragilisée par la crise sociale de 2001 et inquiète du rapprochement avec la Police Nationale ?
Bref, est ce une tentative de nager à contre-courant, une rupture avec la politique menée depuis 2002 ou plus simplement la volonté circonstancielle de rassurer les gendarmes à deux ans d’une échéance politique majeure?
Nager à contre-courant ?
Comme nous l’avons développé dans la chronique « Vers un statut civil de la gendarmerie française. », le rapprochement de la Gendarmerie et de la Police conduit à terme à l’abandon du statut militaire des gendarmes. Ce mouvement semble inéluctable. Mais il a un coût et des conséquences en terme de gestion des forces de police et de sécurité pour l’Etat. C’est un pas que les politiques ont peur de franchir, surtout quand il a été initié par Nicolas Sarkozy. Nous ne pouvons que renvoyer nos lecteurs à cet article (cliquer ici).
Notre analyse a, semble t’il marqué les esprits et fait couler beaucoup d’encre, notamment sur le site de La Saint Cyrienne (cliquer ici), où de fait, une majorité se dégage en faveur de l’abandon du statut militaire du corps de la gendarmerie.
De même, elle a suscité un éditorial de L’Essor de la gendarmerie qui, pour tenter de contrer nos arguments, les déforme ou élude les réponses, pratiquant ainsi de la désinformation, plutôt que de renvoyer ses lecteurs à la version originale de notre propos.
On peut donc voir dans la nomination d’un général de gendarmerie comme patron de l’institution, la volonté du gouvernement de rompre avec la pratique instaurée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale de nommer un magistrat ou un préfet à la tête de la gendarmerie. Ce faisant, cette décision peut être interprétée comme la volonté de montrer que la gendarmerie fait indéfectiblement partie du ministère de la défense et de prévenir ainsi toute tentation sécessionniste future.
Bref, il s’agirait alors d’un retour en arrière, d’un véritable contre-pied à la politique de rapprochement et de coopération avec la police nationale mise en place par Nicolas Sarkozy. Ce changement radical de cap ne se ferait pas sans risques de relancer la guerre des polices.
Mais peut-on réellement revenir, par la simple nomination d’un homme – qui a d’ailleurs été l’artisan de la politique de coopération entre les deux corps au cabinet de Nicolas Sarkozy- sur le rapprochement inéluctable de la police et de la gendarmerie ? Il est difficile de le croire.
De fait, une analyse plus approfondie nous conduit à penser que cette nomination est purement circonstancielle.
Ne pas faire bouger le bateau !
La fonction policière est au coeur même de la notion d’Etat. A deux ans de l’échéance politique majeure que constitue l’élection présidentielle, il était impératif pour le pouvoir en place de ne pas créer les conditions d’une nouvelle crise dans la gendarmerie par une nomination hasardeuse.
Le départ du préfet Mutz, directeur général de la gendarmerie depuis 2002, étant acquis, il fallait dès lors résoudre le problème de son remplacement.
On a sans doute envisagé la nomination d’un haut magistrat de l’ordre judiciaire, toujours appréciée des gendarmes, qui y ont souvent vu, probablement à tort, une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir politique. Mais, de nombreuses raisons ont conduit à écarter cette solution d’emblée. Tout d’abord, depuis plus de vingt ans les magistrats qui ont occupé le poste ont plutôt géré à vue l’institution et l’ont fait peu progresser. De plus, il n’est pas osé de dire que le pouvoir actuel a peu de dilection pour le corps judiciaire, globalement à gauche, et qui a encore sous le coude des dossiers épineux concernant de hautes personnalités politiques. La nomination d’un magistrat aurait donc pu être interprétée comme un gage donné à la magistrature. Enfin, la sélection d’un haut magistrat risquait d’interférer avec le train d’affectations qui s’est concrétisé voici quelques semaines.
On pouvait alors nommer tout simplement un préfet. Il n’en manque pas. Mais une telle nomination n’aurait fait que confirmer la main mise du ministère de l’intérieur sur la gendarmerie. Elle pouvait susciter des commentaires désobligeants, voire des réactions imprévisibles et fâcheuses de la part de gendarmes inquiets. C’était un risque à éviter à deux ans de l’échéance politique majeure des présidentielles. Il fallait donc rassurer les gendarmes.
Restait à trouver une solution d’attente qui, tout en garantissant que le statut ne bougerait pas au moins jusqu’en 2007, assurerait la continuité de la politique de rapprochement, somme toute satisfaisante, mise en place. Dès lors la seule solution était de nommer un général issu du sérail. Bien sûr, le choix d’un militaire pour commander une force de police -caractéristique des régimes autoritaires- peut toujours alimenter des commentaires défavorables. Mais en l’occurrence, il s’agissait sans doute de la solution la moins mauvaise.
Mais fallait-il encore trouver l’homme. Dans toute organisation, lorsqu’on veut éviter un changement brutal d’orientation, garantir la pérennité d’une politique, on nomme l’adjoint à la place du patron promu ou partant à la retraite.
Mais bien sûr, le fait d’occuper la place de n°2 n’est pas le seul mérite du général Parayre.
Car, voilà un général comme les aiment les politiques. Petit sans faire de complexe napoléonien, astucieux avec mesure, possédant les diplômes militaires indispensables et cherchant toujours à faire plaisir d’abord à ses chefs, puis à ses pairs et ses collaborateurs, ce général à la voix et la stature modestes, sera atteint par la limite d’âge (61 ans) en 2008. Cela lui laisse le temps d’assurer la continuité sans faire bouger le bateau.
Et, en effet, il a toujours su naviguer avec brio. C’est ainsi qu’à Marseille, général et patron des gendarmes de la Côte d’Azur, du Languedoc et de Corse, il va se sortir sans trop de mal de l’incendie des paillotes en 1999, en démontrant qu’il est difficile de détecter un feu à une telle distance de la bonne mère ! Il se brûlera tout de même quelques sourcils dans l’affaire ce qui lui vaudra une convalescence de deux ans à Rennes avant de revenir à Paris et d’être nommé au cabinet de Nicolas Sarkozy.
Sa vraie carrière démarre à ce moment. Il conçoit la politique voulue par le ministre plaçant la gendarmerie dans les attributions du ministère de l’intérieur et obtient quelques mois plus tard la place de major général, c’est-à-dire n°2 de la gendarmerie, pour la mettre en oeuvre, provoquant ainsi le départ du titulaire du poste et doublant au passage quelques condisciples plus anciens, qui en conserveront une certaine amertume.
Depuis, il a su gérer le succès sans bruit et avec modestie pour devenir l’homme de la situation à qui le gouvernement offre une belle fin de carrière.
Autant dire que sa nomination est éminemment circonstancielle. Elle va alimenter les commentaires des gendarmes pendant plusieurs mois, les requinquer et leur laisser croire qu’ils sont encore militaires et qu’ils le resteront.
Mais après les deux années prévisibles de calme qui s’annoncent, il faudra à un moment ou un autre tirer les conséquences des évolutions sociétales et européennes en matière de sécurité. Souhaitons qu’entre temps le haut commandement de la gendarmerie ait travaillé sur le sujet afin de ne pas être pris au dépourvu, lorsque l’heure sonnera.