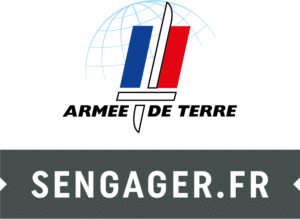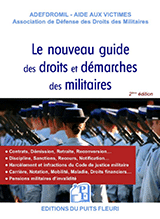N°s 306962-307403-307405 ADEFDROMIL
Section du Contentieux
Séance du 28 novembre 2008
Lecture du 11 décembre 2008
Conclusions de Nicolas Boulouis, Commissaire du Gouvernement
Les 3 requêtes qui viennent d’être appelées vous sont présentées par l’association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL). Elles ont en commun de contester des dispositions réglementaires en tant que celles-ci établissent, pour l’octroi d’avantages financiers à des agents publics, une différence de traitement entre personnes mariées et personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS).
Il s’agit plus précisément :
– en premier lieu, du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France qui constitue une refonte de la réglementation, assez ancienne, en la matière;
– en deuxième et troisième lieux, de deux décrets du 15 mai 2007 qui modifient un décret du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et un décret du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l’aéronautique pour améliorer la situation des allocataires de ces fonds. La vocation de ceux-ci – dont l’existence est prévue par le statut général des militaires – est de verser des prestations sous forme de capital aux ayants cause en cas de décès imputable au service ou en relation avec celui-ci et aux affiliés en cas d’infirmité imputable au service.
Dans les trois cas, les partenaires d’un PACS – qui n’étaient pas pris en compte dans l’état du droit antérieur – sont assimilés à des personnes mariées mais à la condition que le pacte ait une durée d’au moins 3 ans. Il en va ainsi pour la prise en charge des frais de changement de résidence du militaire comme pour le versement des allocations des fonds.
S’agissant des frais de changement de résidence, l’association soutient à juste titre que la réglementation applicable aux agents civils ne prévoit pas cette condition de 3 ans. Tel que modifié par un décret du 22 septembre 2000, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils assimile en effet totalement mariage et PACS.
On aurait pu, à la rigueur, admettre un traitement différencié applicable à l’ensemble des agents publics, sous réserve de sa proportionnalité. L’arrêt Villemain (Ass 28 juin 2002 p 229) l’envisageait d’ailleurs explicitement à propos justement de la prise en compte de frais de voyage et d’indemnité de transport de bagages. Mais, d’une part, le délai de stage de 3 ans inspiré sans doute par les dispositions qui, dans le régime juridique initial du PACS, imposaient un tel délai pour une imposition commune des partenaires du pacte, paraît moins justifiable depuis que la LFI pour 2005 a procédé à un alignement. D’autre part et surtout, dès lors que pour les fonctionnaires civils une stricte égalité de traitement a été prévue entre les deux catégories de personnes, le principe même d’une différence pour le remboursement de ces frais au sein de la seule fonction publique militaire est critiquable. En effet, distinguer entre l’état civil et l’état militaire des agents publics n’est pas pertinent au regard de l’objet de la réglementation, laquelle vise à compenser les charges engendrées par des changements d’affections. Ni la nature, ni la fréquence de ces changements ne sont, entre ces deux grandes catégories d’agents, fondamentalement différents (voir mutatis mutandis pour la non-pertinence du lieu d’affectation comme critère de différenciation entre personnes mariés et concubins ou personnes pacsées pour les frais de déplacement des personnels civils 2 avril 2003 Ajolet Tp 833)
S’agissant des allocations des fonds de prévoyance, la question est un peu moins évidente. Mais aucun des arguments avancés par le ministre, qui souligne principalement les différences de statut juridique, n’emporte la conviction. Pour le bénéfice de ces prestations, il n’est imposé aux mariés ni condition de vie commune ni durée de mariage. C’est assez logique, car il s’agit d’allocations en capital et non de pensions de réversion, pour lesquelles le risque d’un mariage d’intérêt au détriment des finances publiques devrait et pourrait être prévenu (voir 27 juillet 2005, Margain Tp 742). A moins de faire le pari du décès accidentel du conjoint ou du partenaire en service, le but de l’union – quelle qu’en soit la nature juridique – ne peut pas être illégitime à ce titre. Sur la base de quel raisonnement une durée de stage serait-elle imposée aux pacsés et non aux mariés ?
Les moyens des trois requêtes tirés de la méconnaissance du principe d’égalité sont donc fondés.
Vous devriez par suite faire droit aux conclusions d’annulation de ces différentes dispositions réglementaires, divisibles des autres dispositions des décrets, si la recevabilité des requêtes ne posait les problèmes qui ont justifié que votre formation de jugement s’y intéresse.
Le ministre de la défense fait en effet valoir que l’association est un « groupement professionnel militaire à caractère syndical », au sens de l’article L.4121-4 du code de défense. Or selon le 2ème alinéa de cet article « L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. » Il en déduit que l’ADEFDOMIL ne peut agir en justice.
Précisons qu’il est constant que l’ADEFDROMIL est une association régulièrement déclarée à l’encontre de laquelle aucune action visant à sa dissolution n’a été engagée. Et ajoutons, pour ne plus y revenir, que la circonstance que vous n’ayez pas rejeté comme irrecevable la requête qu’elle a formée contre le décret du 7 mai 2001 instituant la Commission de recours des militaires n’est d’aucun secours pour elle. Outre que son recours été joint avec le pourvoi d’un militaire, ce recours a été rejeté au fond (27 novembre 2002 Bourrel et autre p 412).
Pour faire vôtre l’analyse du ministre, il vous faudra répondre aux 5 séries de questions suivantes, d’inégale difficulté :
1° les associations entrent-elles dans le champ de l’article L.4121-4 du code de défense ?
2° Pour apprécier de la capacité à agir d’une association, le juge ne peut-il, ne doit-il pas même s’en tenir aux apparences ?
3° Les dispositions du code impliquent-elles nécessairement qu’une association déclarée pouvant être qualifiée de « groupement professionnel militaire à caractère syndical » ne puisse agir en justice ?
4° Ces dispositions peuvent-elles être arguées d’inconstitutionnalité ou d’incompatibilité avec les stipulations de l’article 11 de la CEDH ?
5° L’ADEFDROMIL est-elle un « groupement professionnel militaire à caractère syndical » ?
1. Il est assuré tout d’abord que l’article L.4121-4 englobe les associations.
Ces dispositions sont issues du nouveau statut général des militaires, promulgué le 24 mars 2005. Mot pour mot, cet alinéa reproduit le 1er alinéa de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1972 qui fixait le précédent statut[1].
Les termes choisis et la rédaction adoptée suscitebt au moins une interrogation, déjà soulevée par M. Le Theule, rapporteur du projet de statut de 1972 à l’Assemblée Nationale : « Le droit français connaît les syndicats et les associations et donne de ces notions […] des définitions précises. Mais il ignore ce qu’est un groupement professionnel à caractère syndical » [2]. Mais les débats montrent que l’imprécision était volontaire et l’est restée au cours de l’élaboration du nouveau statut afin de faire entrer dans le champ de la prohibition tant les syndicats que les associations, et même plus généralement toute structure qui servirait de paravent à une action de type syndical. Le rapport, rendu en 2003, de la commission de révision du statut général présidée par le Pdt Denoix de St-Marc[3] et qui a fortement inspiré le projet de loi le confirme s’il en était besoin : « Faut-il autoriser les militaires à constituer [des associations professionnelles]? Une réponse négative paraît, là encore, s’imposer. La raison d’être d’une association professionnelle est précisément de fédérer les forces individuelles des associés pour constituer une force corporative organisée, suffisante pour faire au besoin pression sur l’autorité hiérarchique dans le but de défendre les droits et intérêts professionnels des associés. Il ne s’agirait finalement de rien d’autre qu’un syndicat sous couvert d’une association (…) ».
Le législateur a tiré les leçons de l’histoire[4].
On se souvient en effet que si la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats ne s’appliquait pas aux fonctionnaires, celle du 1er juillet 1901 sur les associations ne comportait aucune interdiction à leur égard. Les amicales et autres associations de fonctionnaires aux dénominations diverses se sont alors développées par centaines, sans d’ailleurs que le Gouvernement s’y oppose. Poincaré, ministre des finances, déclare ainsi au Sénat en 1906 : « Il n’y a pas de syndicat des agents des contributions indirectes (…) les agents des contributions indirectes sont des fonctionnaires parfaitement corrects (…) Ils se sont formés en association (…) ce qui existe d’ailleurs dans la plupart des administrations publiques, et ce qui est irréprochable » [5]. De fait, vous avez adopté au plan contentieux la même distinction, rejetant des recours formé par des syndicats[6] dont vos arrêts disent que vous les auriez jugé recevables s’ils avaient été formés par des associations et non des syndicats (voir en particulier la décision très motivée et pédagogique du 13 janvier 1922 Boisson et Syndicat national des agents des contributions indirectes p 37; 25 juillet 1939 Medori et Syndicat national des surveillants des Ponts et Chaussées p 526l).
La situation est donc ici différente, le législateur ayant clairement entendu viser les syndicats et les associations.
2. Vient alors la question de savoir si et comment vous devez aborder la question de la capacité à ester en justice d’une association régulièrement déclarée.
Sur un plan général, le principe est fixé en ce sens que la possession de la personnalité morale donne cette capacité sous réserve de deux exceptions :
a) Si en principe, seule une association déclarée peut contester des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elle défend, vous avez admis eu égard aux termes de la loi de 1901 que « les associations même non déclarées puissent se prévaloir d’une existence légale » et dès lors introduire un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif (Ass. 31 décembre 1969 Syndicat de défense des canaux de la Durance p 462 aux concl. contraires du Pdt Morisot CJEG 1970.154, confirmant 21 mars 1919 Dame Polier p 297 avce les conclusions Riboulet ). De fait tel n’est pas le cas, par exemple :
– d’une section syndicale (26 avril 1989 Section syndicale C.F.D.T de la chambre de commerce et d’industrie de Nantes Tables p 837)
– et plus généralement de toute structure ne disposant pas de la personnalité morale (12 février 1958 Station de pilotage de Honfleur p 96),
– si l’on excepte le cas de la défunte COB (5 mai 1993 COB Tp 955) ;
Mais vous avez exclu qu’une association non déclarée puisse défendre des intérêts patrimoniaux (16 octobre 1985, Ministre de l’agriculture c. Société des courses de Questembert-Malestroit, Tables, p.491) ;
b) Alors même qu’elle ne dispose plus de la personnalité morale du fait de sa dissolution – mais il en irait de même d’autres types de personnes morales – une association reste capable d’agir contre la décision qui met fin à son existence (voir entre autres pour l’autorisation donnée à une association étrangère Sect. 22 avril 1955 Association franco-russe dite Roussky-Dom p 202 ).
Mais, indépendamment de la jurisprudence déjà évoquée et sur laquelle nous reviendrons sur la capacité des syndicats, vous ne vous êtes pas prononcés sur la capacité à agir d’une association au regard de son objet, si l’on excepte l’arrêt Polier précité qui relève la licéité de l’objet de l’établissement de bienfaisance requérant, non doté de la personnalité morale.
Ne pourriez-vous pas vous en tenir à l’existence de l’association ?
Vous pourriez être tentés d’adopter la même attitude que celle qui vous a conduits, dans votre arrêt de Section 30 avril 2003 Syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d’eau et d’assainissement (p.189[7]) à regarder comme inopérante la circonstance que le dirigeant d’une personne morale ayant reçu délégation pour introduire une requête aurait été irrégulièrement désigné dans ses fonctions. Il pourrait même s’agir d’un a fortiori. Comme le rappelait JH Stahl dans ses conclusions, « vous êtes pleinement juges de la recevabilité des requêtes qui vous sont soumises » et « il ne saurait être question (…) de questions préjudicielles posées à l’autorité judiciaire, dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où la personne morale serait de droit privé et où une difficulté surgirait dans l’interprétation de ses statuts. » Comme il l’indiquait, cette plénitude de compétence ne vous oblige toutefois pas à trancher les problèmes que vous jugeriez à ce point distincts de celui qui est lié à la recevabilité de la requête qu’il ne pourrait être réglé que dans le cadre d’une autre instance. Et la licéité de l’objet social de l’ADEFDROMIL est un problème en soi, qui relève en outre d’un autre juge que le juge administratif. Vous pourriez donc juger que tant que sa dissolution n’a pas été prononcée, l’ADEFDROMIL est recevable à vous saisir (puisqu’elle existe).
Une telle réponse à la fin de non recevoir ministérielle s’appuierait ainsi conjointement sur l’idée selon laquelle l’existence d’une association suffit à lui donner capacité à agir et sur la conception que vous vous feriez de votre rôle.
Cette réponse présente toutefois de sérieuses faiblesses
Nous pensons tout d’abord qu’elle ne peut qu’artificiellement se réclamer de la solution adoptée par l’arrêt Syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d’eau et d’assainissement. Il ne s’agit pas de prendre parti sur des faits mais de confronter l’objet d’une association à une disposition législative. Cette confrontation, la Cour de cassation accepte de la faire[8]. Vous-même opérez systématiquement la confrontation entre l’objet de l’association et la portée d’un acte pour apprécier son intérêt à agir, comme vous interprétez les stipulations de statuts d’une association pour apprécier la régularité d’une habilitation à représenter ladite association (22 octobre 1965, Dlle Boissière, p.547).
Le refus de qualifier la nature de l’association pour se limiter à son existence se heurterait également au fait que la disposition du statut général imposant une prohibition aux militaires eux-mêmes et pouvant dès lors fonder des sanctions disciplinaires, il vous appartient nécessairement dans cette hypothèse de vous prononcer sur cette qualification afin d’apprécier la légalité de la sanction. Vous l’avez d’ailleurs fait comme juge de cassation à propos de la légalité d’une mesure enjoignant à un militaire de démissionner d’un tel groupement, l’association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés (26 septembre 2007 Rémy n°263747 à mentionner aux tables).
Nous trouverions d’ailleurs contestable que vous vous fondiez sur le droit commun des associations en général et tel que vous l’avez interprété pour la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dans votre décision Syndicat de défense des canaux de la Durance, sans même vous interroger sur la portée exacte d’une disposition législative spéciale.
Enfin, cette position ferait un peu rapidement l’économie du débat de fond et non de pure procédure sur le sort à réserver à votre jurisprudence qui, à ce jour, pour les syndicats à tout le moins, établit un lien de nécessité entre la licéité de l’objet et la capacité à ester en justice pour défendre cet objet.
3. Nous croyons donc que vous devez vous demander quelle est la portée exacte de l’article litigieux du code de la défense. C’est la 3ème question. Sans doute la plus délicate.
Sous l’empire de dispositions refusant aux fonctionnaires le droit syndical (soit avant la loi du 19 octobre 1946), vous jugiez, on l’a vu, qu’un groupement de fonctionnaires, parce qu’il était illégalement constitué en syndicat, n’était pas recevable à agir (Boisson précité). L’existence d’associations, le droit donné à certains agents de l’administration de se syndiquer, l’engagement en 1919 d’une concertation avec les représentants des personnels se prolongeant pas les travaux d’une commission en partie composée de ces représentants et présidée par le vice-président du Conseil d’Etat, Hébrard de Villeneuve, même la reconnaissance de fait du syndicalisme au sein de la fonction publique par la fameuse circulaire du 26 septembre 1924 de Camille Chautemps, ministre de l’Intérieur, ne changea quoi que ce soit à la question juridique. Votre jurisprudence s’est maintenue, étant réaffirmée à un niveau supérieur : Sect.24 mai 1935 Syndicat des agents de maitrise de la manufacture nationale d’armes de Tulle ; p. 590. (Voir également 16 avril 1937 Syndicat indépendant des fonctionnaires et employés de l’institut d’assurances sociales d’Alsace Lorraine (p. 394) ou encore Medori et Syndicat national des surveillants des Ponts et Chaussées précité)
Elle a trouvé un prolongement pour les magistrats. C’est en effet par la réponse à une question purement procédurale – fallait-il admettre l’intervention du syndicat de la magistrature au soutien de la requête de Mlle Obrego ? – que votre décision bien connue de Section du 1er décembre 1972 reconnaît aux magistrats le droit de constituer des syndicats en même temps que la licéité de l’existence du syndicat intervenant et donc sa capacité à agir (voir sur ce point outre la décision les conclusions de Mme Grévisse à la RDP 1973 p 516 et la chronique AJDA 1973 p31 et s.). Dans le silence du statut, devant l’acceptation sociale du syndicalisme judiciaire et l’absence d’opposition du Garde des Sceaux, une réponse purement procédurale paraissait suffisante pour trancher cette question de principe.
Avec l’article L.4121-4 du code de la défense, vous êtes confrontés à une situation a priori différente, qui appelle une réponse moins implicite mais aussi moins évidente, compte tenu, entre autres, de la rédaction du texte qui, littéralement, n’interdit pas le syndicalisme militaire mais le proclame « incompatible avec la discipline militaire ».
On peut certes y voir une périphrase de l’interdiction – c’est le sens des débats parlementaires même s’ils n’expliquent pas le choix des termes employés- et par suite en déduire, comme le ministre, l’incapacité de l’association à agir pour défendre son objet. Il y aurait là l’effet de cette loi conjugué avec l’idée que la légalité et la licéité ne doivent faire qu’une seule et même chose au regard de la recevabilité de l’action en justice.
Mais ce n’est pas la seule lecture ni la seule construction juridique possibles. L’existence formelle d’une personne morale – ici la déclaration de l’association et l’accomplissement des formalités de publicité ou même sa seule existence – pourraient suffire pour agir en justice, d’autant plus que cette action pourrait en l’espèce n’être pas regardée par principe comme « incompatible avec la discipline militaire ».
En effet, tant que l’association n’a pas été dissoute, elle existe légalement et ce qui est incompatible avec la discipline militaire, ce sont, pour reprendre les propos de la commission de révision « l’ingérence dans l’activité des forces, la remise en question de la cohésion des unités, voire de la disponibilité et du loyalisme des militaires » et non le recours pour excès de pouvoir.
L’action contentieuse n’emporte pas, de prime abord, des risques aussi élevés que l’action revendicative dans les enceintes militaires ou sur les théâtres d’opération puisqu’à titre individuel les militaires n’en sont pas privés. Par ailleurs, le droit au recours ou le droit au juge – que n’invoque pas l’association mais qui peuvent servir de guide à l’interprète – pourraient exiger que les restrictions de capacité soient justifiés par des motifs supérieurs, surtout s’agissant du REP, comme le montrent nombre de vos arrêts (entre autres Ass. 17 février 1950 Ministre de l’agriculture c/ Dme Lamotte p 110) et surtout s’agissant du REP d’une association. Alors même que la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations ne « jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 », c’est-à-dire à la déclaration, vous avez dans la décision Syndicat de défense des canaux de la Durance donné raison au commissaire du Gouvernement Riboulet qui dans l’affaire Polier déclarait « l’action de cassation administrative n’est pas fonction de la capacité juridique de celui qui l’invoque » Enfin, il est loisible à l’administration de poursuivre la dissolution de l’association si elle estime que les risques sont trop importants. Elle les tolère aujourd’hui, jugeant préférable de ne pas voir à nouveau surgir dans le débat public cette question sensible.
Cette solution, qui ne diffèrerait que par ses seuls motifs, de celle que nous avons écartée tout à l’heure, mais aurait le mérite, difficilement contestable en soi de reposer aussi sur une interprétation de l’article L.4121-4 CD, ne nous satisfait pas non plus.
Ecartons le droit au juge ou au recours dont aucune juridiction nationale ou internationale n’a à notre connaissance affirmé qu’il était absolu, et donc non subordonné à la capacité et à l’intérêt à agir, comme l’est, avec d’autres, le recours pour excès de pouvoir. Il n’y a donc aucun déni de justice, contrairement à ce que soutient l’association, à se convaincre de l’illégalité des dispositions réglementaires attaquées tout en lui refuser le droit de les contester, sachant que d’autres étaient ou sont recevables à le faire par voie d’action et d’exception.
Si donc la recevabilité de l’action est d’abord en cause, nous ne voyons pas de raison déterminante d’affirmer que la capacité d’une personne morale à ester en justice est liée à la licéité de son objet, au delà de son existence légale. Nous ne méconnaissons pas, s’agissant surtout des associations, la différence entre légalité de l’existence et licéité de l’objet, qui a servi de base à la célèbre décision du Conseil Constitutionnel (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971). Mais il y a quelque difficulté intellectuelle à admettre que le recours pour excès de pouvoir puisse être ouvert pour la défense d’intérêts matériels et moraux à des groupements qui ne peuvent, selon une prohibition législative, se fixer pour but la défense de tels intérêts. Dès lors que vous acceptez de vérifier la légitimité de l’intérêt à agir (voir Sect 27 février 1985 SA Grands travaux et constructions immobilières p 723) [9], pourquoi distingueriez-vous entre la légitimité du but d’une action d’un requérant et celle de l’objet qui fonde toutes les actions susceptibles d’être engagées par ce même requérant ? Sans doute avez-vous fait prévaloir dans la décision Syndicat de défense des canaux de la Durance tout à la fois la nature particulière du droit d’association et du recours pour excès de pouvoir sur les termes mêmes de la loi qui déniaient capacité juridique à une association non déclarée. Mais si une association non déclarée a une « existence légale », pour reprendre les termes que vous avez employés, une association dont l’objet est prohibé par l’article 3 de la loi de 1901, en particulier parce qu’elle est « fondée (…) en vue d’un but illicite » est « nulle et de nulle effet », ce qui rend difficile la reconnaissance d’une existence autre que purement factuelle.
Et, à vouloir nier le lien entre licéité de l’objet de l’association et sa capacité à agir, c’est-à-dire, entre autres, à défendre cet objet devant un juge, on finirait par admettre non seulement qu’une association dont l’objet est prohibé par l’article 3 mais même qu’une association dissoute de ce fait pourraient exister et agir en justice contre tout acte entrant dans le champ de cet objet.
Au demeurant, il ne s’agirait pas tant, en accueillant la FNR du ministre de déclarer ou de reconnaître que l’association requérante ne devrait pas légalement exister parce que son objet est illicite que de faire simplement produire sur un plan contentieux aux dispositions précitées du SG un effet logique eu égard à leur sens et à leur portée, c’est-à-dire lui interdire une action en justice à l’encontre d’un acte entrant dans ce champ.
Ainsi, aucune règle ou aucun principe, pas plus que les différences existant entre associations et syndicats, ne nous paraissent pas justifier s’agissant de la capacité juridique à former un recours pour excès de pouvoir que vous abandonniez votre jurisprudence Syndicat des agents de maitrise de la manufacture nationale d’armes de Tulle.
A la difficulté intellectuelle et juridique de l’abandonner, s’ajoute à notre sens le risque à ouvrir votre prétoire à partir d’une répartition des rôles dans laquelle l’administration continuerait à prohiber l’action syndicale sous toutes ces formes y compris associatives avec, en cas de besoin, le concours du juge judiciaire tandis que le juge administratif sanctionnerait les illégalités dénoncées par les groupements de militaires. Si l’action contentieuse n’est pas toujours la poursuite de l’action revendicative par d’autres moyens, elle peut en effet en être un substitut efficace. Il est intéressant de relever qu’au cours des débats de la loi de 1972, des membres du groupe socialiste avaient défendu un amendement qui prévoyait le droit d’adhérer à des associations professionnelles auxquelles étaient explicitement donné le droit « de se pourvoir contre les actes règlementaires concernant le statut des militaires et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des militaires » Une consultation du Doyen Vedel était invoquée au soutient de l’inconstitutionnalité de l’interdiction qui serait faite aux militaires de s’associer. Selon M. Le Theule, le rapporteur, sur ce point précis de l’action contentieuse, la consultation indiquait au contraire que pour ne pas gêner la discipline ces associations ne pouvaient pas ester en justice (JO Débats AN 1ère séance du 3 mai 1972 p 1281).
On pourrait souhaiter par la reconnaissance de la recevabilité de telles requêtes amorcer une reconnaissance et une acclimatation du droit syndical dans la fonction publique militaire, comme celle qu’a permise la loi de 1901 pour les fonctionnaires civils. Ce serait oublier que ni les textes ni le contexte ne sont les mêmes et que ni les textes ni le contexte ne permettent à notre sens au juge de jouer en l’espèce le rôle annonciateur ou précurseur qui est souvent le sien
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de dire le ministre de la défense peut utilement invoquer les dispositions du code de la défense.
4. Encore faudrait-il que vous écartiez l’exception d’inconstitutionnalité et d’incompatibilité avec les stipulations de la CEDH que soulève l’association requérante[10].
Sur le premier point, la réforme constitutionnelle opérée par la loi n°2008-724 du 23 juillet 2008 a créé, on le sait, un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception selon une procédure fixée par le nouvel article 61-1. Son premier alinéa dispose que « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Le second alinéa du même article renvoie à une loi organique le soin de déterminer les conditions d’application de ces dispositions.
Il est peu douteux qu’une telle loi est indispensable pour que ces dispositions entrent en vigueur, notamment afin de fixer les conditions et modalités de renvoi d’une juridiction au CE ou à la Cour de cassation et le délai dans lequel le CC devra statuer. Cette réforme n’est-elle pas immédiatement applicable dans le cas où, comme en l’espèce, vous êtes saisi directement du moyen et vous estimeriez qu’il peut être écarté sans saisir le CC ? En vous donnant, comme à la Cour de cassation, une possibilité et non une obligation de saisine du CC, l’article 61-1 – et les travaux préparatoires le confirment – vous permet en effet de rejeter de votre propre chef une exception d’inconstitutionnalité non fondée. Or vous jugez, de manière constante, qu’une loi entre en vigueur dès sa publication, à moins qu’elle n’en dispose elle-même autrement, cette entrée en vigueur n’étant pas subordonnée à l’intervention de mesures réglementaires prises pour son application, dès lors que les dispositions en cause sont suffisamment précises (V. par exemple 1er mars 1957, de France, p. 133 ; Ass 10 mars 1961, Union départementale des associations familiales de la Haute Savoie, p. 172 ; Ass 16 juin 1967, Monod, p.256 ; et encore récemment Sect 4 juin 2007 Lagier V. aussi l’enseignement du président Odent à la page 418 de son cours). On pourrait sans doute transposer ce raisonnement au rapport entre loi constitutionnelle et loi organique. Et les dispositions en tant qu’elles prévoient la possibilité notamment pour le CE de rejeter une exception non fondée n’ont besoin d’aucune mesure d’application. Mais en tout état de cause sur ce point, comme sur l’éventuelle indivisibilité de l’article 61-1, les dispositions que l’on trouve à l’article 46 (I) de la loi constitutionnelle tranchent le problème en disposant qu’un certain nombre d’articles dont l’article 61-1 « entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application ». Il résulte clairement de ce § que le fonctionnement de l’ensemble du dispositif est subordonné au vote d’une loi organique.
Vous n’aurez donc pas à vous prononcer au contentieux sur cette question abordée par l’avis rendu que vous avez a rendu le 1er juin 1949 sur ce point[11] et écarterez par suite l’exception d’inconstitutionnalité dans la mesure où pour reprendre la formule du célèbre arrêt de Section Arrighi (6 novembre 1936 p 966), « en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le CE statuant au Cx »
L’association invoque également les stipulations de l’article 11 de la CEDH selon lesquelles « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats (…)./ 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat». L’AFDEFDOMIL estime que l’interdiction absolue instaurée par le législateur serait disproportionnée au but à atteindre.
La difficulté principale réside dans le sens et la portée de la seconde phrase du §2 de l’article 11 qui envisage spécialement le cas de certains agents publics, dont les militaires et sur lequel, à notre connaissance, la Cour ne s’est pas (encore) prononcée clairement.
Il ne faut évidemment pas voir dans ces stipulations le droit pour les Etats de restreindre sans contrainte les libertés en cause pour les agents concernés, a fortiori d’exclure ceux-ci de leur bénéfice sur cette seule base (voir par exemple 26 septembre 1995 Vogt c. Allemagne, série A n° 323).
La légitimité implique que les dispositions prises à l’égard des personnes entrant dans le champ d’application de la seconde phrase le soient conformément au droit national (voir décision de la Commission du 20 janvier 1987 Council of Civil Service Unions et autres c. Royaume-Uni, no 11603/85, Décisions et rapports (DR) 50, p. 228). Dans un arrêt récent du 20 mai 1999 Rekvenyi c/Hongrie n° 25390/94 la Cour précise (§59) que « le terme « légitime » figurant dans cette phrase fait référence exactement à la même notion de légitimité que celle à laquelle la Convention renvoie ailleurs, dans des termes identiques ou similaires, notamment l’expression « prévues par la loi » qui figure dans le second paragraphe des articles 9 à 11. (…) la notion de légitimité utilisée dans la Convention, outre la conformité avec le droit interne, implique également des exigences qualitatives en droit interne telles que la prévisibilité et, de manière générale, l’absence d’arbitraire ». La Cour n’a pas toutefois pas tranché la question de savoir « dans quelle mesure l’ingérence litigieuse, en vertu de la deuxième phrase de l’article 11 § 2, n’est pas soumise à des exigences autres que celle de légitimité », autrement dit, si une condition plus quantitative comme la proportionnalité de la restriction ne devait pas également être imposée. Elle a estimé dans l’affaire Rekvenyi, rendue à propos de l’interdiction faite aux policiers hongrois de s’affilier à un parti politique et de se livrer à des activités politiques, que les exigences de la jurisprudence à propos des restrictions mentionnées dans la 1ère phrase du §2 étaient en tout état de cause remplies en l’espèce. Pour notre part, nous considérons que les auteurs de la Convention ont entendu admettre que la situation des membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat justifiaient des restrictions particulières, ne répondant pas nécessairement à toutes les exigences auxquelles sont soumises celles que prévoit la 1ère phrase du §2, sauf à priver de toute portée utile la seconde phrase. Il va néanmoins de soi qu’il y a lieu de faire des différences entre les forces armées, la police et l’administration de l’Etat, l’ordre d’énumération choisi par les auteurs de la Convention n’étant évidemment pas indifférent et indiquant un sens croissant d’exigences pour reconnaître la conventionalité d’une mesure restrictive.
S’agissant du contenu de ces mesures, il n’est pas exclu par principe qu’elles puissent prendre la forme d’une interdiction pure et simple (voir décision de la Commission N° 8191/78, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne c/Suisse, déc. 10 .10 .79, D .R . 17 p. 93). Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour semble avoir adopté une attitude plus libérale que celle de la Commission « jugeant que les restrictions pouvant être imposées aux trois groupes de personnes cités par l’article 11 – ie membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat- appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question ». (21 novembre 2006 Grande Chambre Demir et Baykara c/Turquie n°34503/97 à propos de syndicats d’agents communaux, c’est-à-dire de personnels n’entrant pas dans le champ de la seconde phrase du §2 ; voir également 21 février 2006 Tüm Haber Sen et Cinar c/ Turquie n°28602/95 à propos de fonctionnaires et d’agents contractuels travaillant dans le secteur public des communications).
Enfin, la Cour a eu l’occasion à plusieurs reprises d’affirmer que l’article 11 doit «s’envisager à la lumière de l’article 10 » (Rekvenyi c/Hongrie). Elle a souligné ainsi que « la protection des opinions personnelles, visée à l’article 10, constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée à l’article 11 » (26 octobre 1995 Vogt C/ Allemagne Grande chambre 7/1994/454/535). Or dans une décision Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, (série A n° 22, pp. 41-42, § 100) la Cour a estimé à propos de l’article 10 et de la liberté d’expression des militaires que « le fonctionnement efficace d’une armée ne se conçoit guère sans des règles juridiques destinées à les empêcher de saper la discipline militaire notamment par des écrits ».
La décision ancienne de la Commission de 1987 qui portait sur la privation du droit syndical des personnels civils d’un service chargé d’assurer la sécurité des communications militaires et officielles du Royaume-Uni et de fournir au Gouvernement des renseignements recueillis grâce à ses dispositifs d’écoute comme l’arrêt Rekvenyi c/Hongrie n’ont pas jugé les mesures nationales incompatibles avec l’article 11.
A notre connaissance la Cour ne s’est jamais prononcée sur les restrictions apportées aux droits des membres des forces armées mais des éléments qui précèdent nous pensons pourvoir vous proposer sans réelle hésitation d’écarter l’exception d’incompatibilité avec l’article 11.
A ce jour, les restrictions du statut sont conformes au droit national : elles ont été prévues par une loi, au surplus très récente, adoptée en connaissance de cause des droits garantis par la Convention. On doit observer ensuite que le nouveau statut général ne comporte plus que l’interdiction de former des groupements professionnels à caractère syndical et celle d’adhérer à un parti politique. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2005, les militaires bénéficient de la liberté totale d’adhérer à des associations non professionnelles et d’y prendre des responsabilités, alors que le statut de 1972 les obligeait à rendre des comptes à leurs supérieurs qui pouvaient en outre faire obstacle à la prise de responsabilité au sein de ces associations. Existent en outre des associations professionnelles à caractère non syndical comme les associations regroupant principalement des retraités ainsi que des amicales d’anciens élèves des écoles d’officiers ou de sous-officiers. Autrement dit, il n’y a pas une interdiction faite aux militaires de bénéficier des droits reconnus par l’article 11, comme le droit d’association au sens large, mais des restrictions d’adhérer à certaines associations.
Ces restrictions sont fortes mais légitimes. Elles visent en effet d’une part à éviter que les forces armées puissent se trouver déstabilisées par des mouvements revendicatifs et une contestation de la hiérarchie et d’autre part, s’agissant du militantisme politique, à la disparition de la neutralité de l’armée, qui est au service de la Nation tout entière. Elles sont contrebalancées par la consécration par le nouveau statut de l’existence et du fonctionnement des organes de concertation, mi désignés, mi élus, au sein desquels avis et attentes professionnelles peuvent s’exprimer.
Si certains, dont la requérante, font valoir que de nombreux pays ont ouvert le syndicalisme aux membres de leur armée, une telle affirmation, avancée au cours des débats parlementaires sur le nouveau statut, doit être relativisée à plusieurs titres. D’une part, les pays généralement cités – Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède et Royaume-Uni ne sont pas, si l’on excepte le dernier, aussi engagés que la France sur des théâtres extérieurs. En outre dans certains d’entre eux, les syndicats illustrent une forme de syndicalisme éloigné de la conception française traditionnelle : ainsi le syndicat des officiers danois rassemble 98% d’entre eux et son directeur est choisi par le Gouvernement. La situation n’est pas très différente en Suède[12]. Enfin, quant aux militaires britanniques, il leur est possible d’adhérer à des syndicats civils sans avoir toutefois le droit de participer aux activités revendicatives, l’intérêt de l’adhésion résidant dans l’aide au reclassement apportée en fin de contrat[13].
Au total, nous vous proposons donc écarter également l’exception d’incompatibilité soulevée par l’association.
Il ne vous aura pas échappé que, depuis la réforme constitutionnelle de juillet dernier, l’ordre dans lequel les réponses aux deux type d’exceptions que nous venons d’examiner peuvent être faites n’est plus en principe indifférent : nous sommes entrés en effet dans un régime de concurrence des exceptions constitutionnelle et conventionnelle. Au sein de ce régime de concurrence pourra même exister une concurrence des questions préjudicielles lors que le droit conventionnel invoqué sera communautaire. Il vous appartiendra de trancher de délicates questions de préséance : la création de l’exception d’inconstitutionnalité constitue entre autres une réaction au fait que « les justiciables sont portés à attacher plus de prix à la norme de droit international qu’à la Constitution elle-même » [14]. En cas d’identité de portée entre une norme constitutionnelle et une norme internationale, l’exception d’inconstitutionnalité devrait donc être prioritaire. Mais si la difficulté est sérieuse, le principe selon lequel le juge doit d’abord vider le litige pour s’assurer que question préjudicielle il y a, devrait-il être écarté au détriment peut-être du droit du justiciable à voir son litige réglé rapidement ?
Quoique l’ordre dans lequel vous répondrez aux exceptions soulevées par l’Adefdromil, qui nous parait naturellement celui que nous avons adopté (voir par 9 novembre 2007 Simone Lasgrezas et Association pour la Protection des Animaux Sauvages), ne soit pas indifférent dans l’absolu, il ne devra en être tiré, à notre sens, aucune conséquence pour le règlement de ces délicates questions, faute que l’article 61-1 soit applicable.
5. Nous en arrivons à la 5ème et dernière question, celle de la nature de l’ADEFDROMIL Ces statuts lui fixent pour unique objet « l’étude et la défense des droits, des intérêts matériels et moraux collectifs ou individuels des militaires » (article 3). Sur son site Internet, elle évoque « son combat en faveur des personnels d’active ». Même si l’adhésion est ouverte à toute personne majeure qui manifeste son intérêt pour la poursuite de l’objet social, il est vraisemblable que les adhérents qui peuvent d’ailleurs ne pas être admis sur décision non motivée du bureau sont essentiellement, sinon exclusivement des militaires.
Il ne fait donc pas de doute qu’il s’agit d’un groupement entrant dans le champ d’application de l’article L.4121-4 et que, par suite, l’ADEFDROMIL n’est donc pas recevable à demander l’annulation des décrets attaqués.
EPCMNC au rejet des requêtes.
[1] Lui-même reprenant à peu de choses près, les dispositions de l’article 58 du règlement de discipline générale dans les armées établi par le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966
[2] Rapport AN 1971-1972 n° 2283 p. 15
[3] « Rapport de la Commission de révision du statut général des militaires » Doc Fr 2003
[4] Voir notamment S. Salon « Le syndicalisme des fonctionnaires : aperçu historique : Cah. fonct. publ. nov. 2000, n° 195
[5] LO Débats, Séance du 7 avril 1906 ; JO 8 avril 1906 p 408)
[7] RJEP, n° 660, juillet 2003, p. 410, concl. Stahl ; AJDA 2003.1150 chron. F. Donnat et D. Casas,
[8] voir Cass.Crim. 13 mai 1908 Martinet à propos de l’incapacité à agir d’un syndicat de fonctionnaire ou 27 novembre 1996 Bull n°431 p 1245 à propos de la capacité d’une association à se porter partie civile compte tenu de son objet comparé aux termes de l’article 162-15-1 du CSP
[9] RFDA 1985.432 concl. B Stirn
[10] Qui paraissent également certaines pour plusieurs observateurs du statut : MD Charlier Dragas « Vers le droit syndical des militaires ? » RDP 2003 p 1073 ; L.Christian « La liberté syndicale des personnels militaires : une vérité juridique à affirmer » AJFP 2005.198 ; pour une position plus mesurée voir X. Latour « Le nouveau statut général des militaires et la concertation dans les forces armées » RFDA 2005 p 770
[11] Avis rendu public entre autres par la circulaire n° 12-A-6174/DN/E.M.P./K du 21 juin 1949 relative au droit des militaires en situation d’activité d’adhérer à des groupements constitués pour soutenir des revendications d’ordre professionnel, Bulletin officiel de la Guerre, p. 2400
[12] Voir R. de BELLESCIZE « La réforme du statut général des militaires (Loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires) » RDP 2006 p 313
[13] « Les droits des politiques et syndicaux des personnels militaires », Les documents de travail du Sénat- Série « Législation comparée », mai 2002,
[14] Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République
Lire également:
Note en délibéré du 8 septembre 2008
Note en délibéré du 4 décembre 2008
Arrêt du Conseil d’Etat n°307405
Arrêt du Conseil d’Etat n°307403