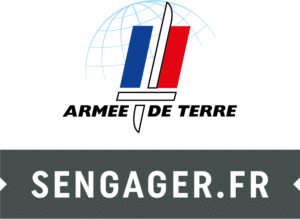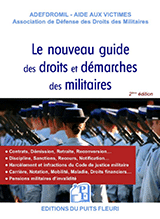Sans l’histoire de Louisette Ighilahriz, racontée à la « une » du Monde le 20 juin 2000, le retour de mémoire des années 2000 sur la guerre d’Algérie n’aurait pas eu lieu. Ce jour-là paraît un court récit en forme de coup de poing. « J’étais allongée nue, toujours nue. Ils pouvaient venir une, deux ou trois fois par jour. Dès que j’entendais le bruit de leurs bottes, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Les minutes me paraissaient des heures, et les heures des jours. Le plus dur, c’est de tenir les premiers jours, de s’habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement. C’est un peu comme si le corps se mettait àflotter… » Louisette Ighilahriz avait 20 ans quand elle s’est retrouvée, grièvement blessée, dans les locaux de la 10e division parachutiste (DP) à Alger, en septembre 1957, après un accrochage avec l’armée française. Pendant sa captivité, elle voit passer de temps à autre Massu et Bigeard, deux des plus hauts responsables militaires de l’époque. C’est un de leurs adjoints, le capitaine Graziani, qui est chargé de l’interroger. Ce pied-noir n’utilise ni la gégène ni le supplice de l’eau pour faire parler sa prisonnière. Il la viole.
Si Louisette Ighilahriz sort de l’enfer au bout de trois mois, c’est grâce à un inconnu, un certain commandant Richaud. Quand cet officier – le médecin militaire de la 10e DP – découvre l’état dans lequel elle est, il s’émeut. « Vous me faitespenser à ma fille », lui dit-il, avant d’ordonner son transfert à l’hôpital, puis en prison. Louisette n’oubliera jamais cet inconnu dont elle ne connaît que le nom. Toute sa vie, elle rêvera de le retrouver pour lui dire merci. Quand elle se confie au Mondeen avril 2000 à Alger, c’est dans l’espoir de le revoir. En imaginant qu’il soit toujours vivant.
L’article, sitôt publié, soulève une émotion considérable. Bigeard menace le journal d’un procès « qui le mettra à genoux » et qualifie le récit de Louisette Ighilahriz de« tissu de mensonges ». « Le commandant Richaud, prétend-il, n’a existé que dans l’imagination de l’ancienne combattante algérienne. » Contre toute attente, c’est le général Massu qui va donner du crédit à cette histoire. « Richaud était l’un de mes bons amis, un homme de grande qualité, un humaniste mais il est mort il y a deux ans », révèle-t-il.
Plus inattendu encore : au cours de cette interview accordée au Monde, Massu avoue que la torture « n’est pas indispensable en temps de guerre » et que l’on pourrait « très bien s’en passer ». « Quand je repense à l’Algérie, cela me désole. La torture faisait partie d’une certaine ambiance. On aurait pu faire les choses différemment », ajoute-t-il. Les « regrets » de Massu créent la stupeur. S’ajoutant à l’histoire de Louisette Ighilahriz, ils déclenchent un « retour du refoulé » sur la guerre d’Algérie auquel personne ne s’attendait. « Jamais je n’aurais cru assister à cela de mon vivant », déclare, bouleversé, l’historien Pierre Vidal-Naquet.
Le Monde décide alors de poursuivre son travail de mémoire, en privilégiant la parole côté algérien. Les reportages s’enchaînent. Le 9 novembre 2000, sort l’histoire de Khéïra Garne, qui vit dans un cimetière d’Alger, entre deux tombes, à demi folle. Khéïra avait 15 ans quand elle a été victime d’un viol collectif commis par des soldats français, à Theniet El-Had, au sud-ouest d’Alger. De ce drame, elle a eu un fils, Mohamed. Cet homme, qui se dit « français par le crime », ne cherche pas à identifier son père – « pour moi, un treillis vide, les yeux vides », dit-il sèchement – mais à faire reconnaître par l’administration française le préjudice qu’il a subi. Il réclame une pension en tant que victime de guerre, souffrant de troubles psychiques. Mais le ministère de la défense la lui refuse, au motif qu’il n’est pas une victime de la guerre d’Algérie puisqu’il en est… le fruit !
« SANS REGRETS NI REMORDS »
L’histoire de Khéïra et Mohamed Garne sera le prélude à une autre enquête duMonde, cette fois-ci sur les viols commis par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Non, les viols n’ont pas été de simples « dérapages » mais ont eu un caractère massif… Cette « découverte-redécouverte » de la guerre d’Algérie prend une tournure plus politique à partir du 31 octobre 2000, avec l’appel des douze. A l’initiative de L’Humanité, douze grands témoins, parmi lesquels Henri Alleg et Pierre Vidal-Naquet, qui avaient pris à la fin des années 1950 un engagement de premier plan, invitent l’Etat français à « promouvoir une démarche de vérité qui ne laisse rien dans l’ombre »…..
Lire la suite sur le site Lemonde .fr en cliquant [ICI]