Un récent débat sur Europe 1 a soulevé la problématique du traitement et du suivi des blessés de guerre. Certains d’entre eux, de retour du théâtre afghan, ont manifesté une déception forte, faute d’avoir reçu la considération qui leur semblait due. Ce manque de reconnaissance illustre la méconnaissance des blessés de guerre par notre société. Pour ne pas creuser davantage le fossé avec son armée, la nation doit parvenir à porter un regard solidaire.
L’histoire de la France s’est principalement forgée par les armes et jusqu’à il y a peu, le soldat mort au combat était, non pas une victime, mais un héros. Ce lien entre la nation et son armée a atteint son apogée après la guerre de 14-18 avec des anciens combattants dont Clémenceau a dit « ils ont des droits sur nous ». La défaite de 1940 et les guerres coloniales ont altéré cette image idéalisée du guerrier qui a achevé de se déliter avec la suppression du service militaire en 1996 et la professionnalisation des armées. A cela s’ajoutent aujourd’hui d’autres facteurs qui creusent encore le fossé entre le soldat et la nation :
– L’évolution de la notion de défense qui perd son sens premier rattaché au soldat. La société ne se sent plus en danger à ses frontières. La menace majeure que les citoyens appréhendent est celle du terrorisme, contre laquelle le soldat n’est pas perçu comme le recours prioritaire. Parallèlement, la notion de guerre se décline davantage aujourd’hui vers des domaines économiques, financiers ou technologiques.
– L’évolution dialectique de notre société. On observe clairement une réticence, souvent pour des raisons juridiques, à utiliser le terme de guerre en matière de conflits armés. Ce fut vrai pour l’Algérie et le pas n’est toujours pas franchi à propos de l’Afghanistan où les actions de combat s’en apparentent pourtant bien. En outre, le concept de « soldat de la paix » entraîne inconsciemment le rejet de la notion de combattant.
– L’évolution de notre politique de défense. L’engagement de la France se réalise le plus souvent dans le cadre d’une alliance ou d’une coalition (OTAN, UE). Cette « internationalisation-dénationalisation » du soldat obscurcit les raisons pour lesquelles il se bat, d’autant que les engagements sont désormais loin de nos frontières.
– Le recours à des sociétés militaires privées. De telles organisations pour remplir des missions militaires de plus en plus larges, brouillent l’image du soldat et portent atteinte à la notion de combattant au service de la nation.
LE DEVOIR DE MÉMOIRE
A ces facteurs, s’ajoute l’immuable image des anciens combattants véhiculée à travers nos commémorations nationales. Remplissant un devoir nécessaire de mémoire, ces cérémonies oublient souvent les blessés des guerres récentes et négliger les plaies ouvertes d’aujourd’hui, c’est souvent empêcher qu’elles se referment demain.
Aujourd’hui demeure donc l’impression que les militaires sont payés pour faire la guerre et en assumer toutes les conséquences. Or nos soldats ne sont pas des mercenaires, ils se battent au nom de leurs concitoyens. Si le soldat a la caractéristique de donner la mort et s’il est blessé au combat, c’est bien au nom de la République. Il est donc du devoir de la nation de l’accompagner dans cette épreuve. Redonner tout son rang au blessé de guerre devrait ainsi être une priorité nationale. Deux mesures peuvent l’y aider, la création d’une entité pour la coordination et le suivi sur le long terme et l’évolution du devoir de mémoire par nos anciens combattants.
Pour l’armée de terre, la cellule d’aide aux blessés, en lien avec…..
Lire la suite sur le site www.lemonde.fr en cliquant [ICI]

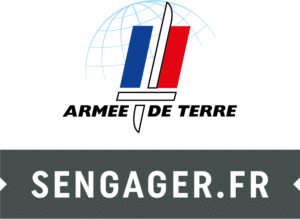

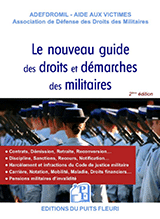

Cette publication a un commentaire
un texte superbe , venant d’un officier qui sait ce dont il parle , mais pour lui combien de ses pairs oublient leurs obligations , celle de s’occuper de leurs hommes , de leurs interets , de leur suivi , de l’attention qu’ils meritent lorsqu’ils sont bléssés , malades , tués!
un rappel a la republique et a ses citoyens n’est pas inconcevable de la part d’un chef , le devoir de reserve a ses limites.
DVL
Les commentaires sont fermés.